L’avant-garde est-elle (toujours) bretonne ?

Atelier d’Estienne, Pont-Scorff, 10 janvier – 21 février 2014
Avec Virginie Barré, Jocelyn Cottencin, Antoine Dorotte, Julie C. Fortier, Benoît-Marie Moriceau, Samir Mougas, Bruno Peinado.
Derrière l’allure provocatrice de ce titre se cache un questionnement à double détente : dans un premier temps, l’existence d’une avant-garde peut-elle être contenue dans les limites d’une région ? Dans un deuxième, c’est l’hypothèse de la Bretagne qui est interrogée ici, sa capacité à se singulariser et à se maintenir dans cette situation très hypothétique qui la distinguerait de ses semblables… L’idée de débattre de la définition de l’avant-garde est du reste bien tentante mais il est à craindre qu’une telle entreprise ne déborde les limites de cette chronique, même si a priori une critique digne de ce nom ne saurait s’arrêter à de telles considérations mesquines et devrait s’obliger à réinterroger ces concepts qui semblent aller de soi. Car, dans l’avant-garde, rien ne va de soi, si ce n’est de s’en tenir à une définition usuelle de ce terme pour en faire un synonyme de ce qui est nouveau, surprenant, inouï, etc. Bref, de confiner la définition de l’avant-garde à son acception courante. Même en s’en tenant à cette définition minimale, on rencontre déjà des difficultés : pour pouvoir édicter ce qui est radicalement nouveau, il faudrait concentrer des qualités d’observateur ubiquitaire, être doté d’une conscience critique maximale et d’une objectivité hypertrophiée, ce qui est rarement le cas même si beaucoup de critiques d’art passent leur temps à courir les expos et ne sont pas si partisans que cela. Et ce serait accorder trop de pouvoir aux critiques d’art qui, au final, ne représentent qu’une modeste partie de la décision quant à savoir ce qui relève de l’avant-garde : les critiques ont certes du poids mais pas plus que les collectionneurs, les directeurs d’institutions, la foule des bloggeurs. Et les critiques d’art sont parisiens pour la plupart. Ce qui n’arrange guère les affaires de la Bretagne dans cette histoire…

Julie. C Fortier, Petrichor, 2013. Edition entre-deux, Nantes, courtesy de l’artiste. Photos © Atelier d’Estienne.
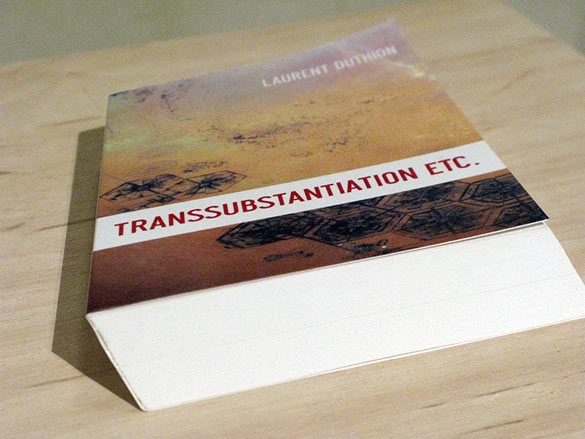
Laurent Duthion, Transsubstantiation etc., 2012, courtesy de l’artiste. Photos © Atelier d’Estienne.
Donc, plus on avance sur la question et plus l’affaire bretonne se corse. Nous avons tendance à penser que la question de l’avant-garde est désormais une chasse gardée des critiques d’art influents et des galeries « qui font Bâle » et la Bretagne n’est pas forcément la mieux dotée dans ce domaine : peu d’organes de presse spécialisée, peu de critiques attitrés et vivant au pays [1] (depuis la disparition de Bernard Lamarche-Vadel qui a pu en son temps avoir une réelle influence dans la région, certains artistes bretons s’en souviennent [2]), peu de collectionneurs patrons (Pinaud peut-il être considéré comme un collectionneur breton ?), peu de galeries influentes (aucune ne fait la Fiac), peu de curateurs de renom, etc.

Antoine Dorotte, Suite d,O, 2010, courtesy galerie ACDC et l’artiste Laurent Duthion, Transsubstantiation etc., 2012, courtesy de l’artiste Samir Mougas, Fumeur noir, 2013, courtesy de l’artiste Bruno Peinado, Big Bang, 2006, courtesy de l’artiste. Photos © Atelier d’Estienne.
Poser le problème de l’avant-garde c’est poser le problème du centralisme français, du déséquilibre entre une province démunie et une capitale où se retrouvent l’essentiel des décideurs : cette prédominance ne suffit cependant pas à accorder à Paris toute latitude prescriptrice, dépendante qu’elle est d’un système mondialisé où cela fait belle lurette que ce ne sont plus les galeries françaises, ni les curateurs français, ni la critique d’art française qui donnent le la. Reposer le problème de l’avant-garde bretonne, au-delà de l’ironie légère qui sourd de l’intitulé, c’est aussi réinterroger les termes de l’accession à la visibilité de ces avant-gardes qui se sont succédé tout au long de la première moitié du XXe siècle et qui, d’une certaine manière, étaient le fait de petits groupes au fonctionnement « artisanal ». Aussi, pour en revenir à la problématique du début, sans vouloir rentrer dans des profondeurs définitionnelles, il est flagrant de constater que les conditions nécessaires à l’établissement d’une avant-garde de nos jours renvoient à la formation de regroupements d’artistes dont l’émergence tient beaucoup plus à la mise en place d’un éventail promotionnel et médiatique qu’à la défense de positions révolutionnaires, positions qui pourtant sont indissociables du concept d’avant-garde. Sans vouloir non plus approfondir les liens de toutes sortes entre avant-garde et révolution (au sens d’un bouleversement de l’establishment), il paraît pour le moins difficile de reparler d’avant-garde sans faire référence aux interrelations très fortes entre production artistique et marché de l’art. Le temps des avant-gardes était justement celui des postures radicales, en lutte avec les productions dominantes de l’époque – l’académisme – qu’elles se chargeaient de bousculer, de rendre obsolètes (même si les marchands avisés étaient depuis le début des avant-gardes des observateurs avisés des artistes de l’avant-garde), alors que désormais on peut craindre qu’il y ait concomitance ou même influence du marché sur les formes soi-disant avant-gardistes. Au-delà de la volonté, certes stimulante, de dépoussiérer un concept qui semble chaque jour un peu plus inadapté, cette réutilisation de l’appellation de l’avant-garde permet une fois de plus de constater l’impuissance des scènes périphériques à pouvoir faire entendre des voix singulières en dehors des connivences en tous genres qui désormais façonnent le fonctionnement du marché de l’art international et décident de la pertinence des formes sensibles à tous les étages.



Antoine Dorotte, Suite d,O, 2010, courtesy galerie ACDC et l’artiste. Photos © Atelier d’Estienne.
Dans cet impitoyable plaidoyer pour dire l’impossibilité de l’avant-garde à être bretonne brillent quelques lueurs d’espoir. Déjà, il existe une véritable « tradition de l’avant-garde » en Bretagne : André Breton aimait séjourner à Nantes — alors pleinement bretonne — où il disait retrouver cette capacité d’étonnement et d’émerveillement qu’il ne pouvait trouver ailleurs qu’à Paris [3]; Michel Leiris, dans sa correspondance avec Jacques Baron, parle de la péninsule bretonne comme d’un endroit propice à la création qui ne se résume pas à l’adoration d’un Monet pour les rochers de Port Coton : pour lui, la dimension océanique de cette terre brassée par les tempêtes serait absolument salutaire pour échapper au climat délétère de la grande ville, même si, dans le commentaire de leur correspondance, il est dit que l’avant-garde est une affaire parisienne [4]. Quand bien même ces références sont désormais lointaines, force est de constater que la Bretagne conserve un attrait certain auprès de nombreux artistes qui ont décidé eux aussi de s’installer dans la région, au risque de renoncer aux opportunités de carrière : dans les années trente, la Bretagne apparaît déjà non pas comme un recours possible pour l’établissement d’avant-gardes concurrentes mais plutôt comme une hypothèse de repli, un contrepoint efficace au maelström de la grande ville où se pratique davantage l’art des mondanités que se prennent de véritables décisions artistiques; on voit bien qu’ici s’opposent deux conceptions de l’élan créatif, le vortex stimulant de la métropole ou bien le calme et le détachement de la province, loin des vicissitudes du monde. À condition toutefois que la décision soit prise en ces termes. Car c’est ici que nous touchons au cœur du problème : la Bretagne, pour ces artistes qui ont choisi d’y rester ou pour ceux qui ont décidé de s’y installer, relève-t-elle d’un choix par défaut ou au contraire du sentiment assumé de pouvoir y développer pleinement leur pratique ? Si ces artistes ont pensé qu’ils pouvaient se passer de la capitale en misant sur les qualités climatiques de la région, c’est aussi qu’ils jugent que la situation artistique de la Bretagne est porteuse et que l’hypothèse d’une alternative aux puissances prescriptrices dominantes est possible ; si c’est uniquement parce que les loyers parisiens les rebutent qu’ils s’y installent, alors la messe est dite.

Laurent Duthion, masques de la série Occurrences, 2013, courtesy de l’artiste Jocelyn Cottencin, œuvre de la série Litanies, conseils et autres idioties, 2010, courtesy de l’artiste. Photos © Atelier d’Estienne.
Dans la liste des artistes présentés à l’atelier d’Estienne à Pont-Scorff, les positions sont loin d’être homogènes entre des Barré-Peinado venus s’installer il y a une dizaine d’années à Douarnenez pour profiter de la quiétude de la baie tout en conservant une attache parisienne avec leur marchand parisien, un Antoine Dorotte qui possède son atelier en banlieue parisienne ou encore un Jocelyn Cottencin véritablement installé à Rennes après ses études aux beaux-arts tout comme Samir Mougas et Laurent Duthion. Le cas de Loïc Raguénès semble bien confirmer l’hypothèse d’une « retraite » provinciale rendue possible grâce au relais de sa galerie étrangère pour ce qui concerne la gestion de sa carrière. Quant à Benoît-Marie Moriceau, il représente un cas à part, celui d’un artiste partagé entre sa galerie nantaise, son appartement rennais et son atelier à Savenay : sorte de fantasme de métropole élargie englobant les deux capitales régionales et ses satellites, dont seule l’offre cumulée permettrait d’atteindre un stade acceptable de propositions. Julie C. Fortier reste inclassable dans la mesure où elle s’est installée à Rennes pour suivre son ami, Yann Sérandour, autre artiste majeur de la scène rennaise, dont l’absence au sein de cette exposition peut étonner. Si cette réunion d’artistes ne fait pas une avant-garde, elle a au moins le mérite de pointer les difficultés d’existence d’une scène régionale tiraillée entre la nécessité d’exister à la capitale et le désir de s’investir auprès de son aire de prédilection : l’autre lueur d’espoir qui atténue ce constat de l’impossibilité d’une avant-garde bretonne et qui, à terme, pourrait le contredire, c’est l’existence en Bretagne d’un réseau de centres d’art et d’associations de tout premier plan qui, de Rennes au Dourven, de Quimper à Brest et désormais à Pont-Scorff procure à cette scène bretonne une incomparable caisse de résonance.
- ↑ Il faut cependant rendre hommage à la figure de Jean-Marc Huitorel, infatigable chroniqueur et auteur d’innombrables textes de catalogues, défenseur s’il en est de la scène bretonne.
- ↑ Bernard-Lamarche Vadel fut enseignant à l’école des beaux-arts de Quimper de 1979 à 1980 qui lui consacra un colloque il y a deux ans. Sa ligne critique « incarnée » et sans concessions, son magnétisme et son rayonnement dans l’Hexagone et hors des frontières contribuèrent à faire mieux connaître la scène bretonne (ou plutôt celle de l’Ouest) et à la désenclaver, quand bien même il n’essaya pas de constituer une quelconque défense de la création contemporaine bretonne.
- ↑ Relire Nadja de Breton…
- ↑ Correspondance Michel Leiris / Jacques Baron, édition établie, annotée et préfacée par Patrice Allain & Gabriel Parnet, éd. Joseph K, Nantes, 2013. Les deux amis séjournent régulièrement en Bretagne, pays qu’ils aiment à retrouver pour ses vertus de ressourcement des idées et de raffermissement du corps (voir notamment la lettre numéro 50, p. 126 qui évoque leur séjour à Tréboul). Pour autant, les auteurs ne contestent à aucun moment le leadership parisien en matière d’avant-garde (voir p. 25 et 27 : « cependant par-delà les chemins escarpés de la lande bretonne qui ont mené Jacques et Michel à la dissidence du mouvement surréaliste, c’est bien à Paris, espace consacré à l’avant-garde… ») ; si Paris est le centre de la vie artistique et culturelle, la Bretagne est l’endroit où Leiris et Baron puisent les forces nécessaires pour s’opposer à des personnalités telles que celle de Breton. Par ailleurs, on sait suffisamment le respect qu’accorde Breton à l’endroit de Jacques Vaché qu’il découvre à Nantes et qu’il estime être le modèle absolu de l’artiste surréaliste. On connaît aussi l’importance de la frange nantaise dans le mouvement surréaliste (voir Nantes : le rêve d’une ville, Musée des beaux-arts de Nantes-RMN, 1995).
- Partage : ,
- Du même auteur : Patrice Allain, 1964-2024, À propos de MAD, entretien avec Sylvie Boulanger, Prix jeune création 2014 : Oriane Amghar, Rosson Crow, Par les temps qui courent au LiFE, Saint-Nazaire,
articles liés
Patrice Allain, 1964-2024
par Patrice Joly
AD HOC
par Elsa Guigo
Bivouac, après naufrage
par Alexandrine Dhainaut

