Everybody in the place. La culture club comme antidote à l’institution d’art contemporain ?

La critique d’art s’est beaucoup penchée dernièrement sur le problème institutionnel et les limites atteintes par les organismes de diffusion culturelle. Qu’il s’agisse de harcèlement au travail, de directions tyranniques, de la programmation des lieux d’art manquant d’inclusivité, de la maintenance des hiérarchies, du patriarcat des conseils d’administration ou de l’ingérence du mécénat des grandes entreprises, les acteurs de l’art les plus progressistes cherchent aujourd’hui à mettre un terme à ces agissements et habitudes dorénavant trop visibles pour être dissimulés. L’heure est à l’imagination d’autres modèles afin de dépasser celui encombrant du système institutionnel actuellement en fonction. Le pouvoir en place, quant à lui, dans le cadre de ses objectifs culturels, reproche très souvent aux programmateurs artistiques de ces mêmes institutions (et donc subventionnées par les collectivités territoriales) de ne pas assez s’ouvrir aux publics non-initiés. Bien qu’ils soient très discutables et rarement objectifs, ces reproches sont parfois partagés par les acteurs de l’art cherchant eux-mêmes à rendre la diffusion de l’art contemporain toujours plus « démocratique ». La conquête de tous les publics demeure actuellement un objectif fondamental pour tout service des publics. Pourtant, après une vingtaine d’années de médiation culturelle poussée, les institutions d’art contemporain, disposant par ailleurs de moyens de communication toujours plus performants, se voient encore et toujours taxer d’élitisme, reprocher d’être des cénacles privilégiant l’entre soi et coupées du « grand public », et peinent à faire comprendre leur fonction d’intérêt général, ne souhaitant pas l’imposer par la force.

Vue de l’exposition au / Exhibition view at Studio 13/16 du Centre Pompidou, Paris.
Courtesy Diane Arques – ADAGP, 2017.
Constatons qu’au même moment, la culture club et rave des années 90 connaît un regain d’intérêt chez les artistes et les acteurs de l’art contemporain, celle-ci arrivant à point nommé pour un milieu socio-professionnel ne sachant comment se délier des contraintes de son système institutionnel. Une pléthore d’œuvres d’artistes, d’essais critiques ou d’expositions attestent du renouveau de cette culture et de l’attrait « cool » que peuvent avoir des clubs emblématiques sur la communauté artistique globalisée. Il semble alors que l’art contemporain voie dans la culture club un format idéal de résolution de sa « crise institutionnelle ».
Le monde de la nuit est indissociable de la vie des artistes ; il leur procure inspiration, divertissement, socialisation licite et illicite par la musique et les substances, mais aussi affinage de réseaux professionnels grâce aux rencontres rendues plus fluides dans une ambiance festive. L’importance de l’univers nocturne pour les artistes ne date d’ailleurs pas d’aujourd’hui, comme le rappelle l’exposition « Into the Night : Cabaret and Clubs in Modern Art »qui s’est tenue au Barbican Centre de Londres en 2019 : la modernité s’est également construite à partir des rassemblements noctambules hors des lieux traditionnellement dévolus à l’art. En cette période de revival des années 90, cet intérêt poussé par la culture club et rave est apparu au milieu des années 2010, comme le soulignait le journaliste Tobias Rapp dans une synthèse sur les scènes de musiques électroniques allemandes : « si une chose était claire en 2015, c’était que la musique électronique en Allemagne était avant tout le projet d’une génération. Les personnes nées entre 1970 et 1990 en Allemagne de l’Ouest et de l’Est, utilisaient toutes de la même manière la house et la techno pour exprimer leur vision du monde ; des gens ayant atteint l’âge adulte dans les années 90 et qui trouvaient le rock ennuyeux ; qui ont vécu la chute du Mur à l’école ; qui ont participé à la Love Parade ; qui ont vécu en direct l’essor et le déclin du mouvement rave, et été par la suite partie prenante du repli de la musique électronique dans une ample niche, dans laquelle celle-ci continue de se développer et de prospérer1. » Si cela est vrai de la scène allemande, il en va de même pour les scènes belge et britannique – toutes les trois étant considérées comme le berceau du mouvement –, mais aussi du reste de l’Europe. Mark Leckey rend constamment hommage aux rave parties dans son œuvre, et tout particulièrement en 2003 lors de sa performance BigBoxStatueAction pendant laquelle l’artiste avait reconstitué un sound system monumental, dialoguant avec une sculpture des années 40 de Jacob Epstein dans la Tate Britain.

De même, Jeremy Deller s’est très tôt intéressé à la popularité de cette culture dans des projets tels que The Search for Bez (1994), Do You Remember The First Time? (1995), mettant en avant le smiley jaune icône de l’acid house, ou encore History of the World et Acid Brass (1997). Mais c’est justement en ces années de réappropriation de la culture club que l’artiste propose une historicisation de ce mouvement avec Everybody in the Place. An Incomplete History of Britain 1984-1992 (2018), dans un souci de transmission pédagogique aux jeunes générations, tout en replaçant cette œuvre dans sa démarche globale d’historien vernaculaire des contre-cultures, voire d’un certain paganisme britannique toujours très présent. Le spectateur suit un cours de l’artiste très didactique, narrant l’épopée d’une jeunesse qui, se trouvant trop à l’étroit dans des night-clubs, décide d’investir la campagne anglaise pour se rassembler autour des musiques techno, house et trance alors en plein essor. Cette vidéo, extrêmement réjouissante mais non dénuée de nostalgie, ne peut que susciter l’adhésion pour un passé encore à portée de main, dont la régénération ne relève pas du fantasme. Ayant grandi à Francfort dans les années 90, ville se disputant avec Berlin les débuts de la techno sur le territoire germanique2, Zuzanna Czebatul fige Tristan, Kewin, Joss (2015) – les meilleurs danseurs des nuits berlinoises du moment – en plein mouvement. Véritable ode à la culture club, cette sculpture présente les jambes des danseurs vêtues de joggings, tronquées mais rassemblées pour toujours. À la fois fun et lugubre, l’œuvre reflète les incertitudes d’une génération qui, si elle doit sombrer, le fera dans un état d’esprit festif et collectivement.

Mousse, polyester, metal / Foam, polyester, metal, 130 × 120 × 120 cm.
Courtesy de l’artiste / Courtesy the artist.
Optant pour une approche différente, Henrike Naumann s’appuie aussi sur la culture club germanique pour interroger la construction idéologique de l’Allemagne réunifiée. Ou comment le croisement entre la montée du nationalisme chez les jeunes de sa génération et l’essor de la culture club en ex-RDA a pu opérer. Élargissant parfois son propos à l’Europe et au monde, elle s’intéresse à la question des origines prétendues de la techno, notamment avec le genre musical new beat dont on trouverait les prémices, selon la doxa occidentale, au club Ancienne Belgique d’Anvers à la fin des années 80. C’est à la suite d’une véritable enquête qui l’a conduite au Congo, que l’artiste tente de réviser l’histoire. Par le biais de la performance NEW BEAT – THIS IS CONGO! (2017) – en étroite collaboration avec les artistes Rachel Nyangombe et Bebson de la Rue – Henrike Naumann propose de reconsidérer les origines du new beat. Généralement présenté comme « purement » belge et n’ayant subi aucune influence des Detroit ou Chicago afro-américains, ce fameux beat s’avérerait être issu de la scène musicale de Kinshasa. Au cœur de cette démarche post-coloniale, la diffusion et les échanges culturels invisibles viennent parasiter une histoire de la musique électronique occidentale trop bien huilée, qui gagnerait à s’extraire d’une paternité revendiquée, teintée de nationalisme refoulé. Amateur et contributeur de la culture club belge, Xavier Mary s’est fréquemment inspiré du mouvement rave dans son travail ces dernières années, jusqu’à ouvrir le project-space DIESEL (2013-2018) dans une station-essence désaffectée des environs de Liège, pour lequel chaque vernissage était animée d’une micro rave party co-organisée avec Noëmie Merca. Si la majorité de ses sculptures et installations sont implicitement associées à l’esthétique industrielle du mouvement rave, Too Many Parties (2017) évoque sans détour l’ingénieux bricolage à l’œuvre dans la construction des sound systems et éclairages ex nihilo des fêtes illégales : bloc massif composé de phares de véhicules variés, sur lequel trône un puissant éclairage blanc capable d’illuminer la plus obscure des nuits, cette sculpture intègre un programme régulant les intervalles et les séquences d’illumination similaire aux consoles d’éclairage des boîtes de nuit. D’une robustesse tout-terrain, Too Many Parties a été conçue pour éclairer n’importe quel festival ou espace d’exposition. Les recherches récentes de Tony Regazzoni évoquent quant à elles l’univers des discothèques de son adolescence, entre decorum kitsch de civilisation antique disparue, découverte de la sexualité gay et disco commerciale de mauvais goût. Associant à l’occasion son travail à la très « Becherienne » série Discothèques (2016-en cours) d’Eric Tabuchi, c’est toute une histoire romantico-émotionnelle des boîtes de nuit françaises de zones rurales ou suburbaines qui, à travers ses œuvres, s’offre à la contemplation.

Performers Rachel Nyangombe and / et Bebson de la Rue. Photo : Chris Shongo.
La culture club est aussi variée que les groupes sociaux qui la font vivre. La communauté LGBT est très souvent à l’origine de nombreux renouvellements musicaux et de nouveaux clubs, d’une décennie à l’autre. Wu Tsang retrace une histoire singulière dans son film-documentaire WILDNESS (2012), celle du club angeleno Silver Platter qui accueille depuis les années 60 la communauté latino-LGBT. Un exemple parmi tant d’autres de catalyseur du monde de la nuit, permettant à chacun de vivre sa vie comme il l’entend en dehors des normes sociétales, en insistant sur cette spécificité du night-club entendu comme un « safe space » pour les communautés en danger à l’extérieur.Charmé par le génie du lieu où se retrouvent surtout des « queens » issues de l’émigration sud-américaine, Wu Tsang y a co-organisépendant un peu plus d’un an les soirées WILDNESS, durant lesquelles DJ sets et performances queer animaient les nuits du mardi. Rapidement victimes de leur succès, de trop nombreux membres de la communauté artistique (souvent blanche) ont commencé à y prendre la place des habituées du club, celles-ci ne se reconnaissant plus dans cette ambiance un peu trop arty…
En cette période de crise sanitaire, Wu Tsang – de même que de nombreux membres de la communauté queer-LGBT – participe à un panel en ligne issu du programme Inferno dans le cadre de Takeover à l’ICA. Takeover consiste à transformer régulièrement le théâtre, le bar et le cinéma de l’ICA en night-club, tard le soir, grâce à des invitations faites aux collectifs de clubs ou aux acteurs de la vie nocturne3. En cette période d’affaiblissement des night-clubs comme de toute vie sociale, Inferno poursuit sa programmation de DJ et créateurs « queer techno rave » issus de l’underground LGBT et tente de maintenir ce lien avec le monde de la nuit, irremplaçable lieu d’émancipation dont cette communauté se trouve temporairement coupée4.

Vidéo monocanal HD avec son stéréo / Single channel HD video with stereo sound, dimensions variables / variable dimensions. Courtesy de l’artiste et / Courtesy the artist and Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin.
Une forme de mélancolie résulte malgré tout de cette situation d’où semble apparaître la perspective d’une fermeture permanente des lieux de sociabilité nocturne comme évoqué avec prescience dans la vidéo Fiesta Forever (2016) de Jorge Jácome. Le spectateur se laisse glisser dans un lent travelling à travers les ruines de hauts lieux de la nuit portugaise tels que la Movida Beach, le Babooshka, le Luziamar, avec en voix-off, de furtifs échanges sur les rituels de l’amour et de la drague en soirée. L’œuvre se présente alors comme « une vision touchante du pouvoir d’être ensemble ». Il est nécessaire de se demander aujourd’hui ce que va devenir la culture club post-Covid19 alors que sont apparues des manières inédites de craindre l’autre, d’éviter le contact, de réfléchir avant de toucher, de partager nos microbes et virus. Le passage du virus et les décisions politiques l’accompagnant auront-ils pour effets de fermer les clubs pour toujours ? Si le sida n’y est pas parvenu, bien qu’il aie mis un terme à une certaine forme d’insouciance, le virus actuel pourrait bien changer la donne. Mais comme tend à le démontrer Fiesta Forever, « au delà des murs la danse est une révolution qui ne saurait s’arrêter. Nous avons simplement besoin de nous rappeler comment nous sentons les choses »5, et nous verrons plus bas comment pourrait évoluer la culture club post-Covid19.
Quoiqu’il en soit, peu de temps avant que le virus n’entraine les décisions de fermeture des night-clubs, la culture club était encore une forte source d’inspiration pour la scène artistique actuelle, notamment chez les artistes berlinois fréquentant le Berghain, passé très rapidement de lieu de sorties nocturnes à un club mythique d’envergure internationale. Le Berghain est ainsi devenu vers 2015 un lieu de passage obligé de la communauté internationale de l’art contemporain qui, lassée de son système institutionnel fragilisé par des polémiques allant crescendo, a facilement pu voir dans la culture club, conjuguée à une nostalgie pour la culture rave des années 90, une sorte de salut. Si nombre d’artistes ou de curateurs et curatrices ont pu oralement faire l’éloge du célèbre club, aucun témoignage écrit n’a été plus révélateur, aussi court soit-il, que celui de Jenny Schlenzka intitulé « What Art Spaces Can Learn From Legendary Berlin Nightclub Berghain ». La curatrice en charge de Performance Space New York y décrit son expérience au sein du club qu’elle n’hésite pas à qualifier de « magique » et constate que tout y est fait de manière à pouvoir se tourner vers les autres plus qu’en soi-même : « j’ai été convaincue que les institutions d’art contemporain devraient cesser de prendre pour modèles les musées ou les théâtres et, à la place, apprendre des night-clubs (…). Les meilleures fêtes sont celles où l’on se retrouve en train de danser et transpirer avec des gens n’ayant que rarement l’occasion d’interagir avec nous dans la vie de tous les jours. Par opposition, les musées et théâtres échouent malgré tous leurs efforts à dépasser la division de classes de leurs visiteurs. » Enfin l’auteur pose plusieurs questions apparaissant comme des idées à mettre en pratique par ses pairs : « À quoi ressemblerait un espace d’art s’il parvenait réellement à briser les barrières de classes aliénantes, les horaires du capitalisme et l’individualisme ? Pourrions-nous créer des espaces ouverts aux expériences de nouveaux collectifs en repensant radicalement les horaires d’ouvertures et l’accessibilité ; en donnant au son la même importance que celle du visuel ? Si les institutions d’art contemporain veulent être réellement contemporaines, encourager de nouvelles idées, des horaires alternatifs et de nouvelles manières de rassembler les gens, alors elles devraient cesser de fétichiser les théâtres et musées pour commencer à faire la fête6. » Pris dans le marasme institutionnel actuel, ce point de vue ne peut que séduire et inciter à modifier la programmation des lieux d’art. Il se dégage pourtant de la spontanéité communicative de cette impression à chaud une certaine naïveté, un manque de recul historique et critique ne nous permettant pas d’adhérer aveuglément à sa cause.

Premièrement parce que cet engouement pour la culture club n’en est pas à son premier volet. Le compositeur berlinois Robert Lippok se souvient que l’art était devenu ennuyeux pour la scène artistique après la chute du mur de Berlin. La vitalité de la culture club leur est apparue plus excitante que l’art, comme une sorte d’exotisme : « Ils voulaient s’élever en utilisant les clubs. Les galeries voulaient tout à coup être des clubs. (…) Du jour au lendemain, tous les artistes voulaient être eux-mêmes des DJs7. » Mais ce n’est pas pour autant que cette expérience est parvenue à mettre un terme aux barrières de classes aliénantes… Ensuite, si des programmations institutionnelles ou des expositions ont dernièrement flirté avec la culture club, il est difficile d’y percevoir une expérience aussi envoûtante et magnétique sur le long terme que celle du night-club. Citons ici l’exposition « Energy Flash – Le mouvement rave » présentée en 2016 au M HKA – Musée d’Art Contemporain d’Anvers qui se voulait être la première à analyser les idéologies et l’esthétique de la culture rave et ses effets sur la culture au sens large. Sans prétention expérimentale, elle restait donc très classique dans son format, et ne donnait qu’une idée assez lointaine et distanciée de l’ambiance de la rave. Il ne s’agissait pas là de déplacer la rave dans l’institution d’art mais de l’examiner comme un objet d’étude. D’autres projets ont en revanche tenté de s’approcher plus en profondeur de l’esprit de la culture club, de ce qu’il dégage de physique et de perceptuel. La double exposition « Tainted Love »organisée par Le Confort Moderne en 2017 (également présentée pour un « Club Edit » à la Villa Arson de Nice) est symptomatique du regain d’intérêt pour la culture club dans l’art, tout en sachant que sa proximité avec la célèbre programmation musicale du lieu n’est pas étrangère à ce choix thématique. Le propos insiste sur les sensations physiques et charnelles perçues dans les clubs de la fin des années 80 – début 90, et les œuvres montrées rassemblent tous les éléments caractérisant l’ambiance club : miroirs, vêtements de soirées, corps enlacés ou en mouvement, sexualité désinhibée, ambiance lumineuse… Décors et images se contentent de reconstituer l’atmosphère du night-club mais les vêtements des clubbers restent désespérément vides de corps… L’exposition ne prétend pas franchir le pas vers un projet davantage performatif et participatif, bien que Le Confort Moderne reste sûrement l’institution d’art contemporain dans laquelle le glissement du lieu d’exposition au dancefloor semble le plus envisageable. Mais lorsque les conditions esthétiques et politiques sont réunies, il n’est pas impossible de convertir l’institution d’art contemporain traditionnelle en night-club temporaire.


C’est effectivement bien une rave party qui a eu lieu dans le hall d’entrée du Ujazdowski – centre d’art contemporain de Varsovie en 2019 à l’occasion de To Be Real8. Organisé en plusieurs parties, To Be Real se présentait comme « un programme musical et performatif examinant le potentiel émancipatoire de la culture club et explorant les relations existant entre politique, vie nocturne et art contemporain, à partir des racines queer de la musique électronique dance des années 70, jusqu’aux manifestations techno récentes dans les rues des métropoles mondiales ». Si l’énergie qu’a pu dégager cet évènement est incontestable, To Be Real était un cri antifasciste bien ancré dans les mouvements sociaux polonais actuels et marquait la fin d’un temps pour le centre d’art polonais : opposé à la montée de l’extrême-droite en Pologne, To Be Real devait rester sans suite alors que la direction de l’institution passait prochainement dans les mains de Piotr Bernatowicz, bien connu pour ses positions ultraconservatrices. Si ce changement de direction semble de mauvais augure pour l’art contemporain, To Be Real a certainement activé une réflexion sur la manière dont la culture club pourrait s’imposer comme outil d’émancipation et ce bien au-delà des clubs et de l’institution d’art contemporain. Aussi, le fait que cette soirée ait occupé un lieu d’art reste par conséquent anecdotique tant les répercussions d’un tel acte dépassent largement son contexte.
Il serait d’ailleurs souhaitable que cette énergie se propage au-delà des clubs (ou de la communauté rave), car, au même titre que l’institution d’art contemporain, la culture club est soumise à des codes ; elle peut être excluante et réservée à une catégorie qui, si elle n’est pas fondée sur les mêmes rapports discriminants de la société bourgeoise normative, reconstitue un système social pouvant pratiquer une forme de rejet de l’autre (même s’il s’agit aussi pour elle, et à juste titre, de se protéger). Que l’on songe aux anecdotes sur les videurs du Berghain et des boîtes de nuit en général, du cordon et de la sélection des entrées, de même qu’aux lieux de rendez-vous tenus secrets des rave parties, il est difficile, comme le fait Jenny Schlenzka, de s’extasier sur la présence de personnes de milieux soi-disant différents, cherchant à atteindre des plaisirs personnels et collectifs9.

Sa proposition omet par ailleurs de se pencher sur les conséquences de la transdisciplinarité sur chacun des domaines de la création. L’art contemporain est désormais bien reconnu pour faire coexister des disciplines, telles que le théâtre et la danse, au cœur d’œuvres performatives, parfois participatives. Il paraît dès lors suranné de voir une nouveauté dans l’idée de faire danser et interagir du public dans une institution d’art contemporain. Et si celle-ci adoptait un format se rapprochant du night-club, que deviendrait celui-ci ? Quelle serait sa spécificité et que lui resterait-il ? Ironie des événements et confinement oblige, ce n’est pas l’institution d’art qui s’est changée en night-club mais le Berghain qui, dans un moment de faiblesse, s’est transformé en lieu d’art. Dans un grand geste bien connu de la philanthropie actuelle, la Fondation Boros s’est associée au Berghain le temps de la fermeture du club, pour y ouvrir une exposition intitulée « Studio.Berlin10 » présentant cent dix-huit artistes de la scène berlinoise, évidement touchés par la crise, et reversant les bénéfices des frais d’entrées à l’équipe du club, elle-même en difficulté. Il importe moins ici de se demander s’il s’agit d’une bonne exposition, que de constater que l’art semble ainsi avoir réalisé un caprice d’enfant gâté en colonisant un espace qui n’est pas fait pour lui, tout en laissant un goût amer aux clubbers ayant l’habitude de fréquenter la boîte. Car si l’initiative a pu paraître « cool » à une communauté artistique adepte du Berghain, un ami artiste également impliqué dans le milieu de la musique, me faisait remarquer que « ce que l’art gagne, la musique le perd ». De nombreux quartiers de métropoles internationales ont aussi beaucoup perdu lors de leur cohabitation avec le milieu de l’art. L’exemple de la gentrification a prouvé combien l’investissement de territoires par l’art ne reste jamais sans conséquence11. Nous croyons que si l’écosystème de l’art ne peut être rendu coupable de tels phénomènes – parce qu’il fait davantage l’objet de manipulations résultant de sa constante précarité –, force est de constater son potentiel destructeur dès que celui-ci touche une réalité autre : de même que l’art permet aux municipalités de renouveler la population de certains quartiers (et aux promoteurs immobiliers d’en augmenter les coûts), il ébranle le mythe et les mystères du Berghain en rendant visible un lieu dont l’invisibilité et les rumeurs avaient contribué à bâtir sa réputation. Robert Lippok qualifiait déjà de « vampiriques » les relations entre la scène artistique et la scène club berlinoise du début des années 90. « À ce moment, il n’y avait pas beaucoup d’impulsion de la part de la scène artistique. Mais ils se sont rendu compte que quelque chose se passait dans les clubs. C’était une sorte de transfert sanguin de l’un vers l’autre, à sens unique12. » Si dans de nombreux cas, et bien malgré lui, l’art s’avère être vampirique et destructeur, il conviendrait d’éviter que ses institutions s’appuient sur des modèles extérieurs pour se renouveler. Elles prendraient certainement le risque de les mettre en danger.
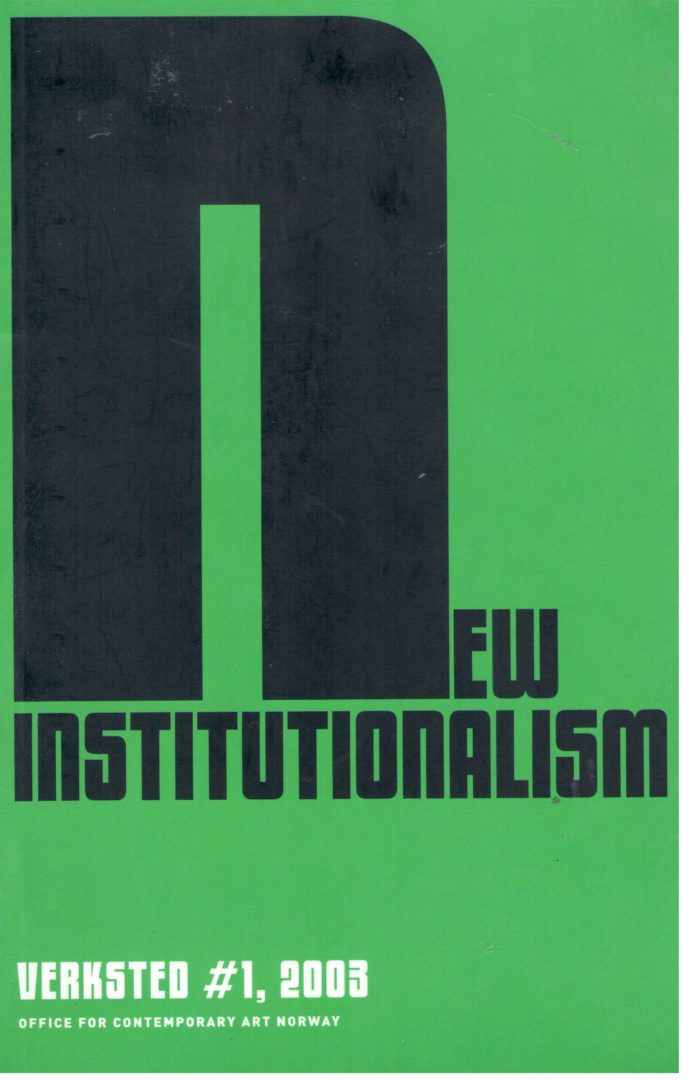
L’art est aussi destructeur quand il s’attaque à lui-même ; et la croyance tenace en une réforme de l’institution de l’intérieur s’est soldée par une suite d’échecs ces quarante dernières années. Malgré des avancées certaines et encore reconnaissables dans les programmes publics d’aujourd’hui, la mouvance néo-institutionnelle de l’art n’est pas parvenue à faire de l’institution d’art contemporain cette grande agora de participation démocratique dont elle avait initié l’élaboration à la fin des années 90 et au début des années 2000. En y programmant la critique institutionnelle et ses valeurs, le « New Institutionalism » a donné les moyens à l‘institution de mieux cadrer cet élan de changement social en réifiant sa portée émancipatrice, n’en faisant qu’une curiosité, un objet esthétique parmi les autres œuvres données à voir. Une fois le temps court de l’expérimentation néo-institutionnelle achevé par des coupes budgétaires, ses curatrices et curateurs, ayant trouvé des postes à plus grande visibilité, ont pu diffuser leurs concepts novateurs à leurs pairs comme à la génération suivante13. Le discours critique reste donc énonçable pour tous les directeurs artistiques à condition qu’il n’évince pas ce qui est attendu de la part des politiques culturelles, c’est-à-dire l’offre de l’expérience d’un objet d’art quel qu’il soit. Tout directrice ou directeur artistique pourra faire ce qu’elle ou il veut, tourner une proposition expérimentale et critique en un discours recevable par la politique normative ; elle ou il ne pourra pas sortir du cadre institutionnel fixé par le pouvoir en place.
Ce que l’on peut retenir aujourd’hui des péripéties du « New Institutionalism14 », c’est que l’institution ne pourra pas se renouveler de l’intérieur et qu’il ne pourra appartenir qu’à des formes expérimentales de l’exposition, extérieures au champ institutionnel, de parvenir à cette liberté totale et non contraignante, ardemment désirée par la communauté artistique. Les exemples d’initiatives ne manquent pas à travers le monde. Des structures non-conventionnées ou délestées de mécènes envahissants, à la communication discrète, parviennent à rester libres de toute contrainte dans leurs discours et perspectives. Depuis son ouverture au début des années 2010, Treignac Projet organise expositions, résidences et groupes de réflexion tout en réaménageant, lentement mais sûrement, ses deux grands bâtiments en lieux de vie, de travail et de monstration. S’y retrouvent à la belle saison des communautés d’artistes rassemblés pour imaginer de nouvelles manières de vivre ensemble à l’échelle du lieu, réinventant ainsi la vie artistique dans l’espace rural. Récemment invitée à Treignac Projet, The Cheapest University est une école expérimentale et libre, nomade et sans programme prédéterminé, qui s’active au gré des invitations et des projets. Partant de la faillite de l’enseignement conventionnel, tel que perçue par ses membres, cette école permet de coproduire des savoirs et de les transmettre. Les œuvres d’art réalisées par les artistes font en outre partie intégrante de leurs différents formats d’enseignements, insistant sur l’importance de l’aspect pédagogique de l’œuvre et de son exposition. Localisé non loin de Tarnac sur le plateau de Millevaches, la Pommerie se veut un lieu d’élaboration occupant cette position particulière de diffuseur de culture contemporaine dans un cadre géographique et social très reculé. Il s’agit d’un lieu de résidence organisant également des cycles de conférences de qualité liées à l’écologie, des expositions et ateliers en relation avec les enjeux propres à son territoire et ceux qui l’habitent. Les œuvres de l’esprit servent ici à rassembler les visiteurs autour de projets communs qu’il s’agit bien de discuter et de construire ensemble. Parce que ces structures prises pour exemples sont déjà politiquement claires avec leurs engagements (qu’ils soient esthétiques, sociaux, pédagogiques, économiques ou parfois tout à la fois), elles bénéficient déjà d’une grande facilité à jongler d’un format de présentation à l’autre. Et danser ensemble sur de la musique, quelle qu’elle soit, à l’occasion de festivals ou d’expositions, apparaît alors comme une évidence. C’est donc peut-être là que l’art et la culture club peuvent se rejoindre, non pas en tant que modèle ou ressource profitable à l’autre, mais en trouvant ces points de jonction leur permettant de devenir des forces esthétique et sociale dans lesquelles quiconque peut reconnaître ses aspirations.

Si le mouvement rave originel a pu être analysé comme apolitique15, le contexte actuel rend difficile une pratique de la culture club comme dépolitisée. Trop de ses sympathisants semblent entrevoir à l’horizon la possibilité d’un renouveau politique pour chacune des communautés qui composent ledit mouvement. Dès lors, et pour apporter une dernière réponse aux propositions de Jenny Schlenzka, la culture club n’est inspirante que si elle se diffuse dans la rue et tente de prendre possession de l’espace public comme souhaite le faire entendre « Three is a Crowd », la prochaine International Biennale of Urban Art OUT OF STH de Wrocław. Bien qu’apparaisse là encore une liste d’artistes participant à une thématique tendance, gageons que le climat insurrectionnel polonais actuel donnera des ailes à ce projet s’intéressant « aux mouvements de rues et des pistes de danse, en observant la manière dont les corps forment des communautés temporaires de par leur présence physique dans l’espace public, et comment ces derniers transforment la réalité passée et créent de nouvelles conjectures16 ». Ce projet a l’avantage d’encourager toute proposition créative et sociale à s’extraire de l’institution pour se propager dans l’univers urbain : « De la révolte des ravers de 2018 en Géorgie en passant par la dimension politique de la culture rave et la pratique queer du clubbing, jusqu’aux mécanismes de constructions de solidarités dans des conditions d’isolation physique forcée, de même que la pratique des plaisirs en situation de crise17 », ce sont ces mouvements de corps dans l’espace public – corps dansants, amoureux, politisés, épuisés, malmenés mais déterminés – qui, encore et toujours, sont les plus inspirants par leur refus de rester statiques. Comme le répétaient sans trêve les hymnes de la house, « Let’s move our body! ».
Que soient remerciés Zuzanna Czebatul, Benjamin Thorel, Merlin Carpenter et Xavier Mary pour leurs apports respectifs.
- Tobias Rapp, « Electronic Music 2015. A Generational Project », 2016, à lire sur : https://www.goethe.de/en/kul/mus/gen/ele/jah/20699019.html
- Tobias Rapp, Op. Cit.
- https://www.ica.art/live/ica-takeovers
- https://www.ica.art/live/inferno
- https://www.vdrome.org/jorge-jacome/
- Jenny Schlenzka, « What Art Spaces Can Learn From Legendary Berlin Nightclub Berghain », janvier 2019, à lire sur : https://www.frieze.com/article/what-art-spaces-can-learn-legendary-berlin-nightclub-berghain
- Robert Lippok on The Relationship Between Berlin Club Culture and Contemporary Art, entretien par Ji-Hun Kim, août 2018, à lire sur : https://daily.redbullmusicacademy.com/2018/08/berlin-club-culture-and-art
- https://u-jazdowski.pl/en/programme/perfo/to-be-real-2
- Jenny Schlenzka, « What Art Spaces Can Learn From Legendary Berlin Nightclub Berghain », janvier 2019, à lire sur : https://www.frieze.com/article/what-art-spaces-can-learn-legendary-berlin-nightclub-berghain
- https://www.studio.berlin/
- Voir à ce sujet Sharon Zukin, Loft Living. Culture and Capital in Urban Changes, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1982, ou encore Martha Rosler, Culture Class, Sternberg Press, Berlin, 2013.
- Robert Lippok on The Relationship Between Berlin Club Culture and Contemporary Art, Op. Cit.
- Pour en savoir plus sur l’histoire du « New Institutionalism », lire « New Institutionalism » Verksted #1, dir. Jonas Ekeberg, Office for Contemporary Art, Oslo, 2003 et plus récemment « (New) Institution(alism) », ONCURATINGn°21, dir. Lucie Kolb & Gabriel Flückiger, Zürich, décembre 2013
- What Ever Happened to New Institutionalism?, dir. James Voorhies, Carpenter Center for the Visual Arts, Cambridge, MA, Sternberg Press, Berlin, 2016
- Helen Evans, Out of Sight Out of Mind : An Analysis of Rave Culture, Wimbledon School of Art, 1992, à lire sur : http://hehe.org.free.fr/hehe/texte/rave/
- Extrait de la note d’intention du projet, à lire sur : https://bwa.wroc.pl/language/en/events/threes-a-crowd-an-exhibition-of-out-of-sth-vi-space-absorbency/
- Ibid.
Image en une : Xavier Mary, Too Many Parties, 2017. Aluminium, phares de camion avants et arrières, câbles néoprènes/Aluminum, truck headlights, truck rear lights, neoprene cables, 146 × 127 × 202 cm. Activée à l’occasion du Festival Supervue/Activated on the occasion of Supervue Festival, Liège, 2017.
Photo : Laura Hinzen.
- Partage : ,
- Du même auteur : Protective Body, Post Human, De l’art « post-Internet »,
articles liés
« Toucher l’insensé »
par Juliette Belleret
Une exploration des acquisitions récentes du Cnap
par Vanessa Morisset
Le marathon du commissaire : Frac Sud, Mucem, Mac Marseille
par Patrice Joly

