Au cœur de la marge : pour une littérature vivante, Jean-Max Colard sur le festival Extra !
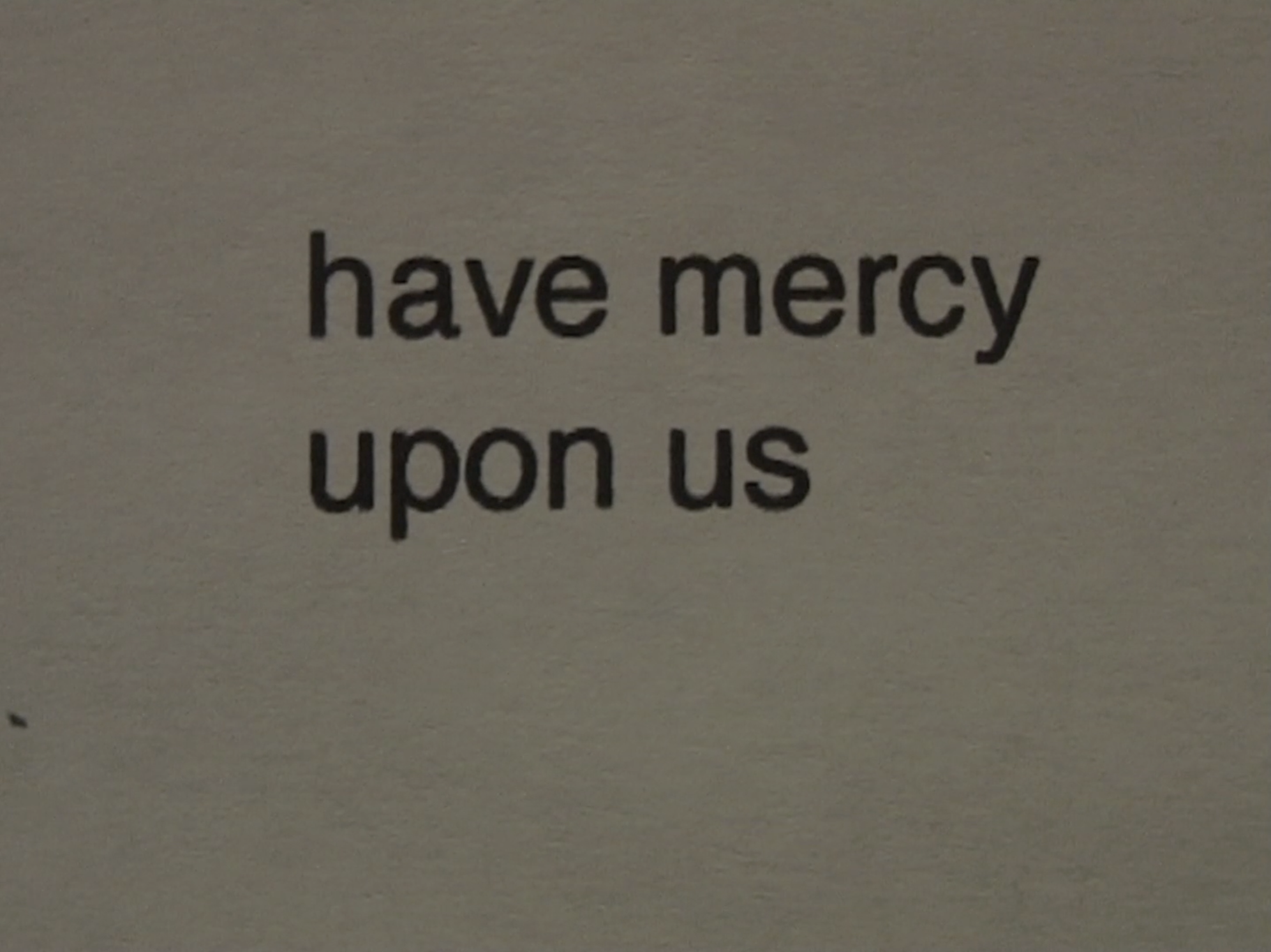
Le chef de la parole est dans un sac poubelle et me conseille de déguster du chou mariné avec une carte vitale. Après une visite au Centre-Pompidou, Jean-Max Colard me propose d’y retourner, une fois la nuit tombée, afin de participer à un banquet « BioHardcore ». Étant plutôt hardcore que bio, une certaine hésitation me conduit au sous-sol du musée. En contemplant la vaseline sur le corps étoilé d’une des performeuses, je repense à la phrase de Barthes, « le langage est une peau ».
La littérature, comme l’art, c’est avant tout un prétexte pour vivre avec intensité.
Depuis 2017, Jean-Max Colard, critique d’art, commissaire d’exposition et grand lecteur, propose un rendez-vous qui secoue le paradigme du festival de littérature. Du 12 au 22 septembre 2024, le Centre Pompidou accueille la 8ème édition du festival Extra ! Entre performances, lectures orales, conférences, projections, ou encore opéra expérimental, cette manifestation illustre la vitalité de la création littéraire contemporaine. Dans son bureau où les livres s’accumulent comme des pyramides, nous avons discuté de poésie, du partage du sensible, de la curiosité comme remède à l’hantologie et d’une littérature qui, comme le temps, est hors de ses gonds.

Suzanne Vallejo-Gomez : Le festival Extra ! est une invitation à la rencontre, avec des livres, mais aussi avec des personnalités, et avec des publics, qui d’usage ne se croisent pas forcément. Le titre que tu portes au Centre Pompidou m’inspire beaucoup d’humour par son côté quelque peu bureaucratique. Tu es le chef du service de la parole. C’est un peu Orwellien comme appellation, ça me fait penser au Ministère de la Vérité dans 1984. Donner la parole c’est accorder une représentation, attribuer un espace, tu œuvres chaque année à proposer un programme généreux, qui navigue entre les disciplines. Extra ! témoigne de la panoplie des formes que la littérature peut prendre, entre performances, lectures, films, ou encore musique. Samedi 14 septembre, il y avait la projection du film de Luce Ebene, artiste dont le travail est sélectionné pour le troisième prix Utopie. Dans la présentation de sa pratique, ton programme déclare qu’iel « transcende les marges de l’effacement ». Alors, en tant que chef de la parole, dans un contexte aussi institutionalisé que celui du Centre Pompidou, comment donne-t-on la parole à ceux et celles qui se trouvent à la marge ?
Jean-Max Colard : Il y a pas mal de sujets dans cette question ! En effet, cet intitulé peut paraitre bureaucratique. Parfois pour rire, je parle d’un numéro vert du Centre, SOS Pompidou. Pourtant, on peut aussi se dire qu’il s’agit d’un titre assez rare et qui possède une certaine beauté. Nous disposons donc d’un service de la parole, au même titre qu’existe un service des expositions ou encore du cinéma. En regardant l’ensemble du Centre Pompidou, on comprend qu’une programmation artistique est accordée à la parole. Je trouve ce concept génial, d’imaginer la parole comme un espace de création et de diffusion d’idées. Nous ne sommes pas un service dépendant de celui de la médiation ou encore des publics. La programmation du service de la parole peut suivre sur certains points celle du Centre mais nous disposons d’un éventail de libertés, c’est une grande originalité pour un musée. À ma connaissance, il n’y a pas d’équivalent dans une autre institution, même dans des lieux comme le MoMa. J’ai souhaité mettre en avant une parole qui sort des salles de conférences, qui inspire au débat, à la rencontre, en investissant la totalité du musée, sous nombreuses formes et circonstances différentes.
Pour le sujet de la « marge », et de donner la parole à ceux qui s’y trouvent, je dirais qu’il ne s’agit pas vraiment de l’objet du festival. Nous souhaitons proposer un évènement qui souligne la vitalité de la création littéraire. Quelque part, créer un festival de littérature qui s’échappe du livre, c’est déjà s’inscrire dans une position marginale. Je crois que plutôt de parler de marge, nous nous situons aussi au cœur de la création littéraire, qui n’est plus imaginée à partir d’un centre précis. J’aime l’idée de dépasser la conception du festival traditionnel de littérature, en proposant quelque chose à l’entrecroisement des arts-plastiques, visuels, et de la littérature. Luce Ebene était nominée pour le prix Utopie, le jury trouvait que son film faisait écho dans le contexte d’Extra ! Le sujet de la représentation des personnes dites à la marge, comme les communautés Queer, n’est pas vraiment une position marginale dans le monde de l’art, en revanche c’est contemporain. J’aime concevoir un festival comme un magazine, prenons 02. Comme vous, nous essayons de prendre le pouls du moment. Je souhaite capturer l’air du temps littéraire, et le restituer dans une programmation variée, allant du centre aux marges, du classique à l’expérimental.
SVG : « L’écrivain n’est pas malade mais plutôt médecin » disait Deleuze. Justement, tu as invité l’écrivaine Laure Limongi avec qui le public peut prendre rendez-vous pour des consultations dites médicales, dans lesquelles elle prescrit des livres. Plusieurs livres m’ont accompagné à des moments qui paraissaient à l’époque insurmontables. En relisant Spectres de ma Vie de Mark Fisher, je souhaitais te questionner sur le rapport entre littérature et remède à l’hantologie. Si tu devais nous prescrire trois livres, pour nous donner envie de vivre, ou du moins de concevoir un lendemain, lesquels seraient-ils ?
J-M.C : Je rencontre toujours des difficultés avec ces questions. D’abord, c’est Laure Limongi qui prescrit, pas moi. Elle reçoit les gens, qui émettent leurs troubles, et elle travaille sur une bibliothèque pour eux. Je n’ai pas de livre en particulier à prescrire, je crois que pour une bonne prescription, il y a une posologie, il faut s’adapter au patient. Toutefois, pour faire face à l’hantologie, il faudrait au moins du contemporain dans cette prescription. Surtout, le remède principal, c’est la curiosité.
S’il fallait te donner un livre, le premier auquel je pense est Le Club des enfants perdus d’Emmanuelle Bayamack-Tam, qui écrit également sous le pseudonyme de Rebecca Lighieri. Ce livre vient de paraître le mois dernier et il s’agit de l’ouvrage le plus important de ma rentée littéraire. J’ai trouvé ce roman drôle, bouleversant, surprenant et cette lecture fut une véritable aventure. Mais souviens toi, c’est la curiosité la solution.

SVG : Toujours sur Fisher, la question de la temporalité, ou plutôt de la lente annulation du futur est particulièrement importante pour le domaine de la littérature mais aussi du cinéma et de la musique. D’ailleurs, des figures comme Paul B. Preciado, que tu as invité à nombreuses reprises à Pompidou et notamment à l’édition 2022 d’Extra, citent souvent la phrase de Hamlet « Time is out of joint ». Ce festival s’inscrit aussi dans un hommage à la littérature dite contemporaine, par exemple vendredi dernier tu as organisé une journée d’étude avec Dominique Viart sur ce thème. Aussi, cette manifestation est l’occasion de présenter la rentrée littéraire, comme pendant le Libé lecture club ce 22 septembre. Face à un temps hors de ses gonds, peut-on encore parler d’une littérature contemporaine, ou même d’un genre littéraire ?
J-M.C : Le terme « contemporain », évidemment il est discutable, en littérature comme en art. On cherche à sortir de ce paradigme. J’aime parler de littérature plasticienne, en désignant un champ vaste de la littérature, en dehors du champ littéraire. On a tendance à territorialiser les disciplines, j’essaie de dépasser ces frontières avec Extra ! La littérature plasticienne fait écho à la photographie plasticienne de Dominique Baqué. Aussi, Michel Chaillou proposait l’expression « littérature de l’extrême contemporain ». Ça fait 40 ans qu’on est dans le contemporain, c’est un peu long. Baudelaire parlait déjà du contemporain, on se trouve dans une échelle de temps qui ne va plus. Un autre terme que j’ai adopté c’est celui de la littérature vivante, ça ne veut pas dire qu’on puisse parler de littérature morte, même si par moments on pourrait se demander. Je parle de littérature vivante pour insister sur la sortie de l’hégémonie du livre. Comment imaginer un festival de littérature quand le livre n’est plus l’unique incarnation de la production littéraire ?
Je trouve que l’expression d’Hamlet est particulièrement intéressante pour la littérature, il n’y a plus de linéarité, ça va dans tous les sens. Olivia Rosenthal écrit des textes pour la scène qu’elle ne publie pas en un livre. En 2018, on a attribué le prix littéraire du Centre à Michèle Métail, elle parle de « publication orale » et pendant longtemps refusait de publier ses livres. Pareil, Bernard Heidsieck nous parle de poésie debout, allant à l’encontre de la littérature couchée. Je suis persuadé que ce combat des marges des années 1960-70 est plutôt gagné aujourd’hui. Les écrivains sont obligés de trouver des formes de publication qui sortent du livre papier, en performant, en allant à la rencontre du public, en faisant des bandes-annonces. Cela nous amène aussi au sujet de l’adaptation cinématographique. Pendant longtemps, on partait du postulat qu’il fallait passer du livre au film, alors que pas du tout.
J’ai écrit un essai en 2015 intitulé « Une littérature d’après », sur le roman Cinéma de l’écrivain Tanguy Viel. Ce texte consiste en la réécriture du film Sleuth de Mankiewicz. C’est donc complètement possible d’inverser les tendances. La littérature aussi est « out of joint », elle est prise dans ce désordre du temps. D’ailleurs, le terme Extra invite à un certain enjouement, il y a toute une vitalité dans cette évolution du livre. Comment peut-on continuer à être littéraire dans un monde qui ne l’est plus ?
SVG : Faut-il brûler Kafka ? Tu te souviens peut-être de cette polémique lancée par des intellectuels communistes dans la revue Action en 1946. Godard disait il ne faut pas bruler les livres, sinon on pourra plus les critiquer. En tant que responsable de la parole au Centre Pompidou, tu as une visibilité conséquente et tu dois donc faire attention vis-à-vis de ta programmation qui s’étend bien au-delà du festival. Comment dialoguer avec des littératures du passé, dans une culture du cancel ?
J-M.C : Je crois qu’il faut au contraire, continuer à relire les textes du passé mais tout simplement à l’aune des enjeux contemporains. En 2021, pour le festival Extra, j’ai organisé une lecture, avec Vanessa Springora, intitulée : Relire « Lolita », la littérature à l’ère de #MeToo.
J’ai toujours pensé qu’il s’agissait d’un livre sulfureux et un peu immoral. D’ailleurs, l’ouverture du texte sur le procès du personnage Umbert Umbert, était selon-moi une précaution, une façon de rendre le roman acceptable de la part de l’auteur. En discutant avec Vanessa Springora, elle m’expliquait que cette ouverture, au contraire, est à prendre très sérieusement, qu’il s’agit d’une façon de dénoncer la monstruosité de ce personnage. En ce sens, le livre a une certaine moralité, il ne s’agit pas d’un fantasme, mais d’une dénonciation. On a donc fait une séquence proposant de relire ce livre. Il faut inclure une relecture des chefs-d’œuvre en les situant autour des enjeux contemporains. D’ailleurs, consacrer des figures du passé permet parfois de mettre en avant des personnalités laissées à l’écart. En donnant le prix d’honneur de la littérature à Michèle Métail, il s’agissait aussi de mettre en avant une figure féminine de la poésie sonore, dont l’histoire s’est davantage raconté au masculin.
Relire ne veut pas dire reconduire les interprétations du passé.
SVG : Dans Oh ! To be a painter, Virginia Woolf rappelle la relation entre écriture et peinture. Les deux pratiques impliquent le fait de commencer quelque part, de construire dans le vide, de faire le premier pas, ou peut-être le premier faux-pas. Est-ce-que tu comprends la peinture comme un genre de littérature ?
J-M.C : Pas du tout. C’est important de comprendre qu’il y a une spécificité des médiums, des champs. En revanche, il y a des termes qui peuvent circuler, le sujet des « écritures » au pluriel. Le cinéma c’est aussi de l’écriture, ça n’en fait pas de la littérature. La création littéraire peut s’initier dans la peinture, je pense notamment à Adrien van Melle et ses toiles textuelles qui lui permettent de développer une peinture fiction, comme son travail sur le cimetière juif de Thessalonique. Je crois qu’il faut pouvoir garder la spécificité des médiums.
En 1766, quand Lessing écrit son texte sur le Laocoon, il distingue les spécificités de la littérature, peinture, sculpture, et c’est tout le XIXème siècle qui va porter cet héritage. Comment relier à nouveau les arts séparés ? Baudelaire fait des correspondances. Wagner propose l’œuvre d’art totale. Il s’agit de réponses à cette séparation des arts, qui ne cessent de se mélanger, se réinventer, et je trouve cela passionnant à suivre.
SVG : Je discutais avec un ami qui me parlait de la fâcheuse tendance à l’exposition étagère. Lorsqu’on ouvre les portes des espaces d’exposition aux livres, on se retrouve souvent dans une forme d’exposition assez agaçante, sur le plan à la fois scénographique comme sur celui du commissariat. « Peut-on exposer le livre » était d’ailleurs une des thématiques autour de ton exposition Duras Song au centre Pompidou en 2014. Alors, par quels moyens exposer le livre sans tomber dans le piège de l’exposition étagère ?
J-M.C : C’est une question qui vraiment me passionne. Pour Duras Song à Pompidou, le sujet n’était pas d’exposer un livre, le sous-titre de l’exposition c’était « portrait d’une écriture ». L’idée n’était pas d’exposer les livres de Duras, car dans ce cas c’est simple, on construit des étagères.
Je souhaitais faire entrer les spectateurs au sein d’un espace littéraire. Le point de départ est difficile, montrer des livres n’est pas l’équivalent de faire une exposition sur la littérature. Cette question implique un champ de recherche assez large, je vais essayer d’y répondre succinctement. Il y a deux voies, d’un côté l’exposition étagère, je préfère d’ailleurs le terme « bibliothécaire ». L’autre piste, plus intéressante selon-moi, est de sortir de la bibliothèque. J’essaie de m’intéresser à une exposition littéraire en prenant par exemple le point de départ de la maison de l’écrivain, ou alors d’un de ses personnages. Dans tous les cas, j’adore cette question. J’ai écrit un article qui s’appelle « L’inexposable » où je m’intéresse à ce sujet depuis le XIXème siècle.

SVG : Il y a un très beau livre où l’écrivain Édouard Louis dialogue avec Ken Loach, dans ce contexte, Édouard Louis parle de la pratique du cinéaste comme d’une « esthétique de la confrontation ». Pour cette 8ème édition d’Extra, un hommage particulier est rendu au cinéaste et poète lituanien Jonas Mekas. Pendant les dix jours du festival son dernier film, Requiem, est diffusé en continu au Centre Pompidou. Dans ce film, on passe de scènes de prairies et de fleurs à des brusques images de famines, guerres et violences. Ce film, le dernier du cinéaste, réalisé en 2019, témoigne de la banalisation de la violence. Dans le contexte actuel, avec la guerre que mène Israël contre la Palestine, ou encore la Russie contre l’Ukraine, nous sommes exposés de façon absolument banale à des destructions massives de populations. Crois-tu que les images du film de Mekas puissent encore choquer ? Face à la surmédiatisation de ce genre de scènes, avons-nous perdu notre sensibilité à la violence ?
J-M.C : Tout d’abord, je ne crois vraiment pas que le but de Mekas soit le choc. C’est davantage ta seconde hypothèse, celle de la sensibilité. En organisant le Jonas Mekas Poetry Day, on partage ce projet partout dans le monde. Dimanche 15 septembre, on parlait de Mekas aussi bien à Pompidou, qu’à Téhéran ou à Lviv en Ukraine. Soudainement, cet artiste se trouve au cœur d’une initiative qui forme un moment de répit face à la violence du monde, un moment de partage du sensible. À Lviv comme à Téhéran, c’est une forme de résistance.
SVG : Dans une interview tu disais t’inscrire dans une démarche davantage poétique qu’historique. Dans ce festival, tu accordes une place importante à la poésie, pas seulement écrite mais aussi sonore, avec Bernard Heidseik, et visuelle, avec Jonas Mekas. Comment cultiver son approche poétique dans une actualité historique aussi cacophonique ?
J-M.C : Lorsque je parle d’une approche davantage poétique qu’historique, c’est davantage lié au sujet de l’exposition. Je m’intéresse aux composants de l’exposition. J’ai toujours beaucoup dialogué avec Christian Bernard, le fondateur du MAMCO, qui parle d’exposition comme un « répertoire de formes ». Au fond, on tourne autour de diverses variantes, je pense qu’il est important de cultiver une approche poétique. Je ne suis pas historien d’art, ni conservateur, je refuse donc d’être porteur d’un quelconque récit de l’art. D’ailleurs, je pense qu’il y a une forme d’anachronisme dans cette conception de l’exposition, il y a tellement de récits à porter aujourd’hui. C’est davantage intéressant d’avoir une approche poétique, ou plutôt poétologique, puisque je distingue la poésie du poétique.
J’ai remarqué que la poésie a sa place, elle est de plus en plus présente autour de nous. Bonne ou mauvaise. Par exemple, si on observe la scène de l’art contemporain, il y a beaucoup de poèmes qui circulent. Il n’y a pas d’économie de la poésie, elle se trouve à l’antipode du système de l’art dominé par le marché, elle joue donc encore son rôle comme figure de résistance. De nos jours, l’art contemporain est comparable à une industrie culturelle, je ne déplore pas cette évolution, mais je trouve que dans ce contexte, c’est touchant de voir des artistes qui substituent un communiqué de presse avec un poème. La poésie circule d’ailleurs mieux aujourd’hui qu’autres formes, elle est plus brève, plus adaptée au peu de temps que nous accordent nos écrans. L’endroit où la poésie compte le moins c’est dans le monde de l’édition, je souhaitais donc mettre en avant cette pratique dans Extra !
Head image : Image tirée de Requiem de Jonas Mekas © courtesy of the estate of Jonas Mekas
articles liés
Interview de Gregory Lang pour Territoires Hétérotopiques
par Patrice Joly
Geert Lovink : « Pas une seule génération ne s’est élevée contre Zuckerberg »
par Ingrid Luquet-Gad
Céline Poulin
par Andréanne Béguin

