Hoël Duret
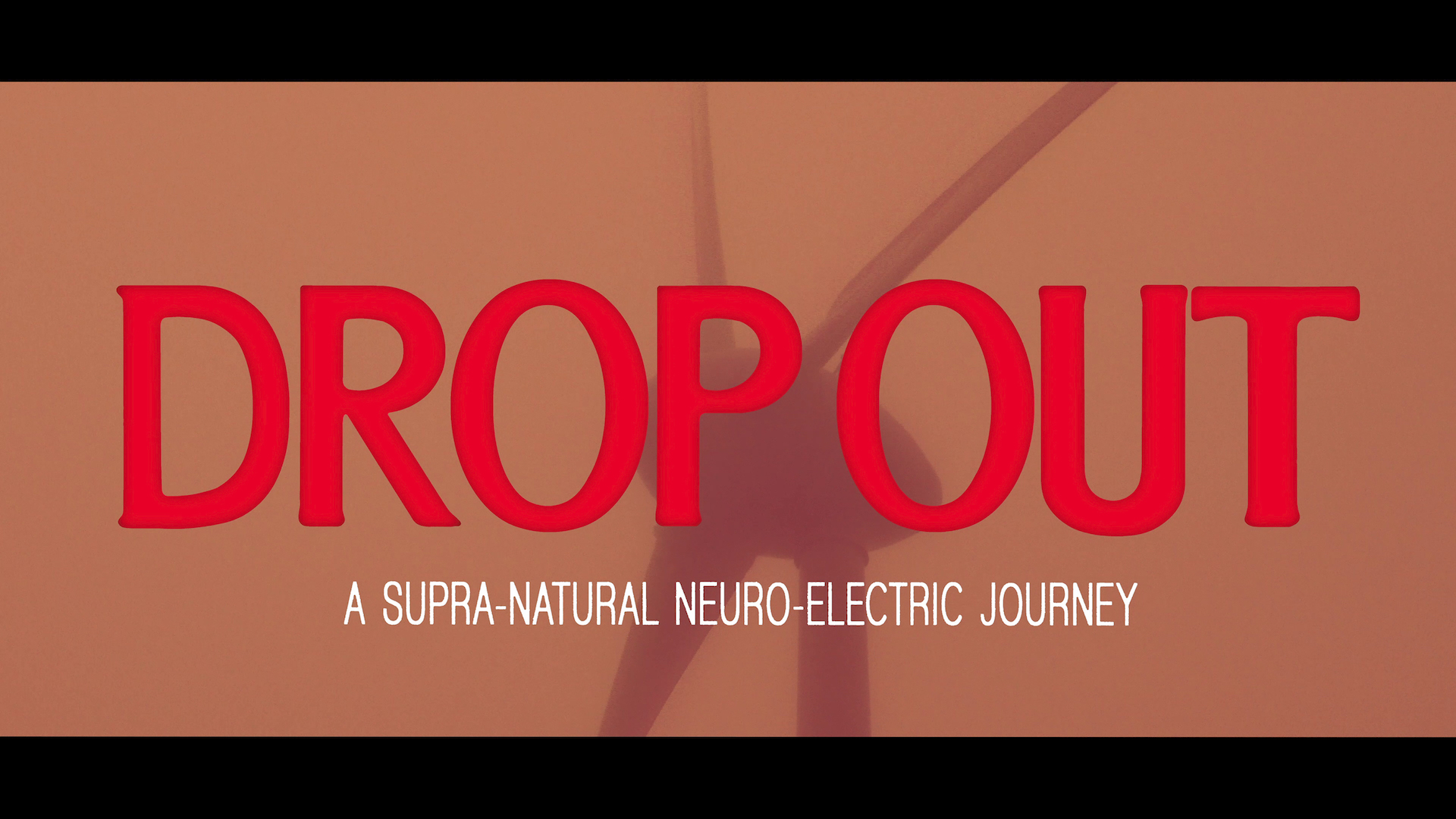
D’une catastrophe à venir qui nous barre déjà l’horizon, nous ressentons déjà le souffle chaud sur notre nuque, signe qu’elle se rapproche, de plus en plus au point que nous la ressentons dès lors comme une présence physique dont la pandémie constituerait alors, en même temps qu’un souffle et une disruption concrète, sensible et physique, un avertissement magnanime et une répétition avant le grand bouleversement. Comment, alors, en tant qu’artiste, réagir face à l’inéluctable ? Comment agir depuis son domaine, celui des images et des imaginaires, tout en ne tombant pas dans un commentaire surplombant qui ne serait pas seulement vain et biaisé mais tout simplement impossible, puisque ce qui se joue concerne précisément l’écroulement de tous les récits, et de tous les repères ?
Le film Drop Out d’Hoël Duret se garde bien de répondre mais s’imprègne de ces questionnements, tant dans son imaginaire que dans son intrigue, afin de les complexifier encore davantage. Imaginé comme une climate-fiction hallucinée peuplée de richissimes réfugiés climatiques et d’une bande de désoeuvrés englués dans un trip éveillé aussi moite que bad, sa réalisation bascule alors que le tournage est contraint de s’adapter à un réel qui rattrape la fiction. Le résultat intègre dès lors ces péripéties et se reçoit comme la mise en abyme doucement loufoque de l’impossibilité, pour l’humain autant que pour l’artiste, de planifier de manière rationnelle le cours des événements, alors que le monde redevient, pour nous, pour le bipède, un hiéroglyphe imprévisible et tempétueux.
Au début de l’année, un projet de film t’amène en Nouvelle Zélande où le ciel se colore du jaune soufre des incendies qui déciment l’Australie voisine… Peux-tu nous raconter ton arrivée sur les lieux ?
Je suis arrivé à Wellington fin janvier 2020 pour une résidence de 4 mois. J’avais rédigé le scénario d’un film d’anticipation durant l’été 2019 mais j’en avais laissé certaines séquences en écriture. Je devais travailler ces points du récit avec les étudiants de l’Université Massey qui m’accueillait. J’ai rapidement loué une voiture et fait le tour du pays pour filmer les séquences déjà bouclées afin de commencer à travailler avec le graphiste Jean Marc Ballée pour ajouter des animations en surimpression à ces images vidéo. Tout était bien préparé et j’avais rapidement commencé à travailler.

Quelques semaines plus tard, le confinement gagne l’Asie et, à sa suite, le reste de la planète. Tu es en train de tourner sur place. À quel moment te rends-tu compte que le projet, déjà teinté de dystopie, va désormais devoir tenir compte d’un réel qui rattrape la fiction ?
La crise sanitaire a touché la Nouvelle-Zélande alors que j’étais en plein workshop d’écriture et de tournage avec les étudiants. Dès le lendemain, j’étais enfermé seul dans mon atelier pour deux mois, soit jusqu’à la fin de ma résidence. Je n’avais pas eu le temps de filmer toutes mes séquences, il me manquait un tiers du film. Il s’agissait de la partie en co-écriture avec les étudiants qui devaient mettre en scène un groupe survivaliste isolé dans la forêt. Comme il n’était plus possible de filmer, j’ai dû trouver une astuce. J’ai profité des dernières heures avant le confinement pour tourner un maximum de plans dans la forêt. J’ai ensuite commencé à enregistrer les conversations quotidiennes que j’avais avec des amis en les préparant. J’y glissais des questions, des orientations pour saisir la sidération qui touchait le monde entier tout en gardant un niveau de dialogue très banal. Cela m’a permis d’écrire les discussions entre les personnages que je ne pouvais plus filmer. Ils oscillent tous entre un ennui profond et des moments de délire personnel mais, surtout, ils n’échangent pas entre eux, ou du moins, ne font plus semblant.
Quelles solutions as-tu mises en place afin d’intégrer à une réalisation suspendue à ses conditions de réalisation le contexte en question qui va dès lors en infléchir la forme ?
J’ai vite constaté qu’avec l’utilisation de la visioconférence, de nombreux filtres vidéo étaient apparus sur Instagram, Messenger, etc. En cherchant parmi ces milliers de filtres, j’en ai trouvé une série qui me permettait d’appliquer des masques d’animaux sur mon visage. J’ai remplacé mes acteurs survivalistes par ces animaux en me filmant avec ces filtres. Pour les incruster par-dessus les images filmées dans la forêt, j’ai dû les agrandir et les déformer, ce qui leur donne beaucoup d’imperfections et de bugs. On voit souvent mes cheveux d’ailleurs, c’est très mal fait, très low tech, mais ça les rend encore plus effrayants. J’ai choisi d’utiliser des avatars d’animaux car ils suscitent immédiatement de l’empathie, bien que les miens soient plutôt déglingues et cinglés.

Au cœur du film, tu inscris également une composante socio-économique. Certes, les imaginaires animistes sont séduisants mais l’intrigue montre quant à elle comment la crise climatique amplifie la fracture entre les plus riches et le reste…
Quatre séquences du film sont traitées en animation. On y voit des plans larges de paysages de la Nouvelle-Zélande avec une colorimétrie très modifiée par-dessus lesquels évoluent en surimpression des formes en animation. Ce sont des formes abstraites qui évoluent d’une séquence à l’autre et aucune explication n’est donnée sur leur nature. Il s’agit de bunkers, des formes architecturées de défense et de protection, car depuis les années 2000 de nombreux investisseurs internationaux se sont construit des villas bunkers de luxe dans le pays. La Nouvelle-Zélande accueille des survivalistes fortunés qui ne s’entraînent pas à la survie mais s’achètent une garantie de repli en cas de crise sanitaire ou sociale majeure. Dans ce pays de greenwashing, on explose des montagnes à la dynamite pour répondre à la demande des plus riches.
As-tu l’impression, en ayant déjà réfléchi à ces thèmes, que la pandémie a exacerbé cet aspect économique, dès lors transformé en une question de vie et de mort pour les plus vulnérables ?
C’est absolument certain, et je pense que si je n’ai pas pu le voir, c’est parce que l’explosion du tissu social comme effet de la distanciation isole et rend d’autant plus inaudibles les plus vulnérables. La rapidité de la disparition des plus fragiles ainsi que l’aggravation violente de leurs conditions sont effrayantes. Bien entendu, ce n’est pas nouveau puisque nous serons toujours très aptes à faire disparaître ce que nous ne souhaitons pas voir, mais c’est l’accélération du phénomène qui est particulière à cette crise.
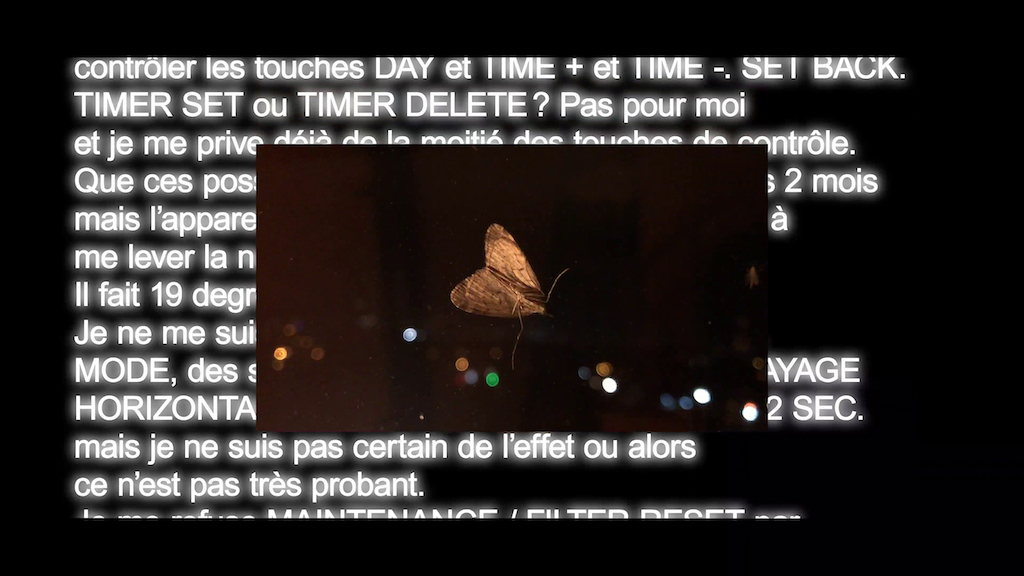
En quoi la fiction te paraît-elle à même d’élargir nos manières de négocier les crises et d’habiter un monde en mutation ?
La fiction est l’angle d’approche qui me semble le plus adéquat, car elle permet d’embrasser un maximum de possibles. Notre monde est vaste et complexe mais la proximité de l’information l’a réduit sans pour autant nous donner de nouveaux outils d’analyse pour l’appréhender. La fiction me permet de travailler par l’absurde, l’ironie, l’exagération, la saturation… Autant de ressorts qui mettent le contenu à distance et le banalisent. Dans ce film, j’ai par exemple beaucoup utilisé le small talk, ce qui me permet de suggérer que toutes les histoires se valent. Notre monde en est une somme plurielle et infinie.
La fiction permet de mettre à distance les grands récits qui ne sont plus à attendre de notre époque, ce qui nous aiderait aussi à ne plus attendre de figure providentielle. À mon sens, le principal enjeu de la fiction aujourd’hui va résider dans le ton adopté par les auteur·e·s face à cette instabilité globale. Pour ma part, je prêche pour une écriture qui évite la moralisation car cette dernière ne permet aucune projection du spectateur qui est réduit à y chercher uniquement la chute et la leçon. Je pense que la fiction et l’anticipation sont de bons supports d’appréhension de la complexité, mais la tentation d’une moralisation simpliste et rassurante est dangereuse.

Le film que tu as tourné en Nouvelle-Zélande constitue le cœur d’un projet d’exposition à venir à la Villa Merkel à Esslingen en Allemagne. Quelle forme prendra l’exposition ?
Le film Drop Out est la charnière entre l’installation NFT pH<7 logique que j’ai réalisée en 2019 pour mon exposition à la Fondation Louis Vuitton et une suite que j’espère pouvoir lui donner dans les années à venir. Ce film reprend certaines de mes thématiques déjà bien explorées pour les remettre en perspective via le prisme de la fiction et donc ouvrir de nouvelles possibilités de travail. Dans l’exposition, on pourra donc revoir l’installation, le film et les prémices d’une suite, à savoir une série de sculptures en verre et de gravures sur plexiglass. Il s’agit des outils et des observations d’une équipe scientifique fictive partie à la recherche de peintures pariétales laissées par une branche de la lignée humaine éteinte lors de l’évolution. Puisque notre pensée fondée sur la rationalité des mathématiques n’a pas su générer l’intelligence sensible capable de prévenir une telle crise sanitaire, cette mission scientifique part à la recherche d’une autre origine de l’écriture, dans l’espoir qu’un tout autre modèle d’appréhension du monde pourrait en découler. L’exposition présentera les premiers objets de cette recherche, en attendant que je puisse réaliser cette vidéo.
Toutes les images : Hoël Duret, Drop out, 2020, vidéo 4K sonore, 23’05″ (extrait). © Hoël Duret / ADAGP, Paris, 2020
Drop out sera projeté cet été au CAPC de Bordeaux et dans le cadre du festival EXTRA ! au Centre Pompidou (11-27 décembre 2020)
- Partage : ,
- Du même auteur : Clara Schulmann, Yves Citton et Jacopo Rasmi, Clément Cogitore, L'Intervalle de Résonance, Douglas Gordon, I had nowhere to go, Le best of d'Ingrid Luquet-Gad,
articles liés
L’Attitude de la Pictures Generation de François Aubart
par Fiona Vilmer
Erwan Mahéo – la Sirène
par Patrice Joly
Helen Mirra
par Guillaume Lasserre