Nicolas Bourriaud
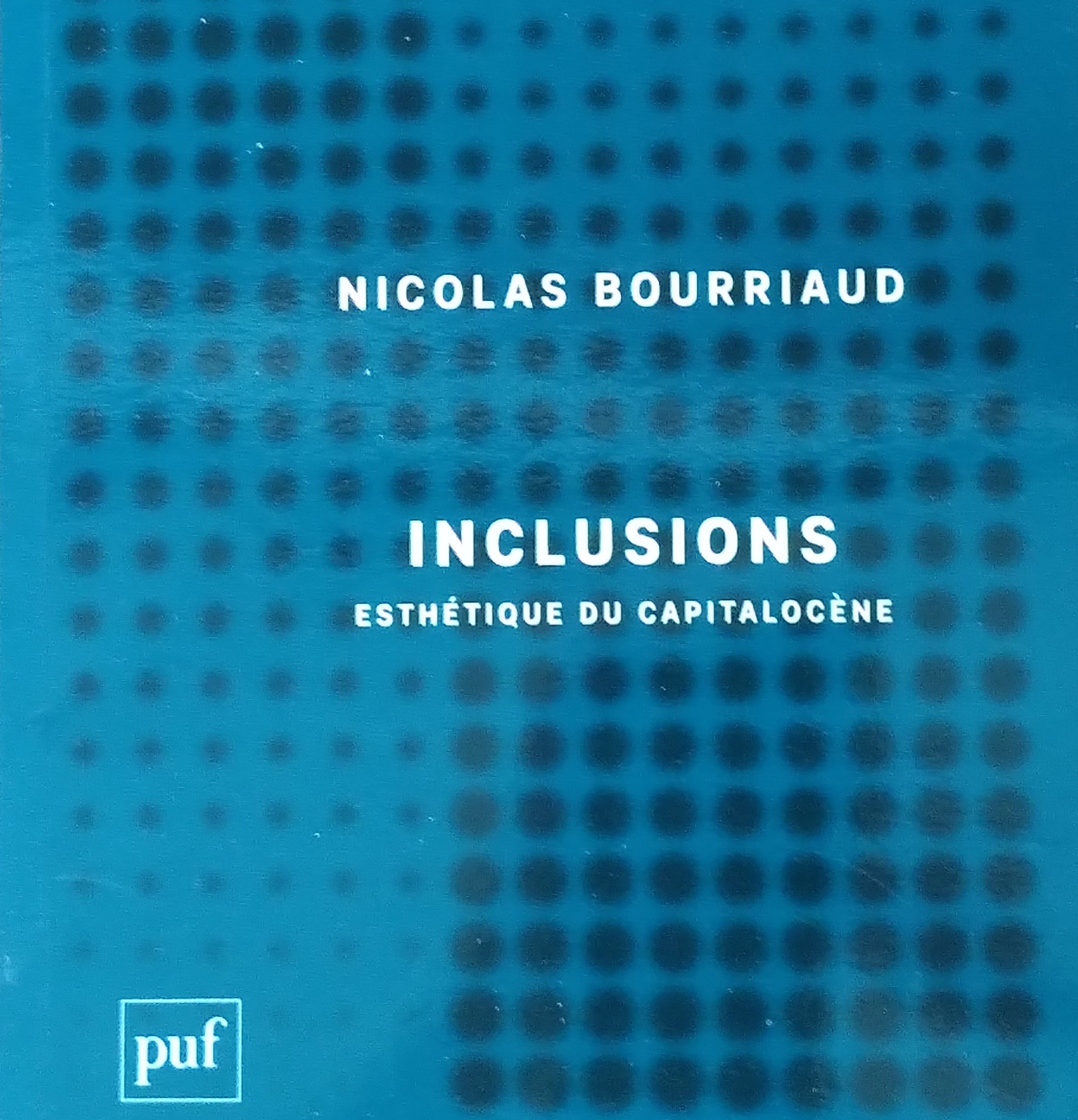
Nicolas Bourriaud, Inclusions / Esthétique du capitalocène, Collection: Perspectives critiques, Editions PUF, 2021
Votre livre, qui s’intitule Inclusions– un concept issu du champ du handicap, propose de replacer l’artiste dans un écosystème. Qui cet écosystème doit-il inclure ? L’artiste « dominant » : blanc, homme, occidental doit-il laisser sa place ?
Personne ne devrait « laisser sa place » à personne : ce serait là une pensée de l’exclusion, qui m’est étrangère. Et on ne combat pas une forme d’exclusion par son inversion. Le concept de pensée inclusive, que mon essai tente de développer, part d’un constat : le réchauffement climatique, et plus généralement l’action de l’être humain sur la planète, a amené de nouvelles conceptions de l’espace-temps, que l’on peut percevoir clairement dans l’art contemporain. Tout d’abord un sens de la promiscuité globale : pour aller vite, la finance mondialisée peut dépendre d’un animal sauvage vendu sur un marché chinois, acheter tel produit à Paris entraîne une déforestation au Pérou. Ensuite, une véritable crise de l’échelle humaine : plus rien n’est purement « humain », ni purement « naturel ». Nous sommes immergé·e·s dans un espace sans bords ni limites, dont le moteur s’avère être des molécules invisibles à l’œil nu, depuis les pesticides jusqu’aux virus. Ce que j’appelle « une pensée artistique inclusive », c’est donc avant tout l’inclusion du vivant dans la forme, la reconnaissance par l’artiste que le monde n’est pas constitué de figures sur des fonds. Tout est surface, et tout est actif. Il n’existe pas d’objets, mais des êtres. Cette inclusion-là, c’est celle de l’artiste qui n’est plus face au monde, mais immergé·e dans une substance active, qu’il·elle travaille par des cadrages, des montages ou des assemblages. Le motif principal de cette pensée inclusive, c’est l’effacement des jeux d’oppositions et de dominations par lesquels le capitalisme patriarcal a fondé sa vision du monde : la forme sur la matière, le sujet sur l’objet, l’homme sur la femme, le civilisé sur le « sauvage »… Tout découle de la première, telle qu’Aristote l’a formulée au quatrième siècle avant Jésus-Christ : créer, ce serait imposer une forme à une matière. Il s’agit aujourd’hui de défaire ce nœud originel. Et c’est ce à quoi s’attachent les artistes que je cite dans ce livre.
Vous parlez « d’esthétique de la décroissance ». Justement, les artistes n’ont-ils pas été les premiers à critiquer la « valeur-travail » et le statut d’agent-producteur ? Duchamp et son ready-made, Hantaï qui cesse de produire, les minimalistes et tant d’autres ont-ils été précurseurs de la décroissance sans le savoir ?
Le néolithique est le moment historique pendant lequel l’espèce humaine a cessé de se considérer comme immergée dans son milieu, et a commencé à s’en détacher progressivement. C’est le moment où le contrôle des écosystèmes humains s’amplifie par l’agriculture et par l’élevage ; mais aussi, et ce n’est pas un hasard, celui où l’art et la magie prennent des chemins séparés. Notre époque est le deuxième grand épisode de cette domestication, sauf qu’aujourd’hui, c’est l’être humain qui « s’auto-colonise », comme disait Lévi-Strauss, et qui constitue sa propre matière première. Les êtres et les choses ont été standardisés par le monde industriel, réduits à des unités de base. Une esthétique de la décroissance, ce serait la prise en compte du fait qu’il existe d’autres registres artistiques que celui de la production : on peut conduire les choses, faire fermenter des substances, recycler… Il s’agit moins, d’ailleurs, de sortir du monde productif que de le transformer. Pour moi, l’art, c’est un ensemble d’émissions. Et toutes les émissions ne sont pas toxiques, ni énergivores.
On retrouve cette coopération nouvelle entre l’artiste et l’animal, dont le principe d’inclusion invite à « faire avec » chez Jan Dibbets, Hubert Duprat ou, plus récemment, chez Céline Cléron, Mircea Cantor ou Olivier Darné. Celle-ci est-elle une révolution artistique dans la conception traditionnelle de l’artiste comme démiurge et omniscient ?
Dans Inclusions, j’essaie d’interroger la distinction classique entre les productions humaines et animales. L’art, en Occident, est devenu le symbole de la séparation nature/culture. On partage l’idée de société avec les fourmis ou les abeilles, la notion d’outil avec une centaine d’espèces animales, mais l’art est généralement considéré comme une expression spécifiquement humaine, qui lui permet l’intellection de son univers, sa compréhension. Charles Darwin distinguait trois régimes de la beauté naturelle : la beauté formelle, liée à l’intuition darwinienne d’un ordre esthétique sous-jacent (notamment dans l’adaptation parfaite d’une fonction naturelle à sa structure organique). Ensuite, la beauté née d’une relation écologique, celle que développeront Deleuze et Guattari dans leur fameux texte sur « la guêpe et l’orchidée ». En gros, la coopération. Et enfin, la beauté née de la sélection sexuelle : l’existence du sentiment du beau est, pour Darwin, le moteur de l’évolution. Je le cite : « La différence d’esprit entre l’Homme et les animaux supérieurs, aussi grande soit-elle, est certainement une différence de degré et non de nature. » Plus tard, Roger Caillois montrera que l’art n’est pas une spécificité humaine : le papillon s’incorpore le tableau, l’artiste humain l’externalise sur un autre type de surface, et l’activité artistique humaine « constitue un cas particulier de la nature ». Donc, pour répondre à votre question, les artistes ont depuis longtemps collaboré avec l’animal pour créer des formes, mais la question demeure intacte : quel est le rôle de l’art humain dans l’écosystème général ? Et en quoi cette prise en compte du vivant nous éclaire-t-elle sur l’anthropocène ? Tomás Saraceno travaille avec des araignées, Pierre Huyghe avec des cellules cancéreuses, Pamela Rosenkranz avec des bactéries… Les œuvres d’art humaines sont aussi ce que le zoologue Adolf Portmann appelait des « organes de l’apparaître », les formules plastiques de l’expression d’une individualité, quelle qu’elle soit. Mes recherches m’amènent à voir l’art comme une expression territoriale, proche de ce que Deleuze voyait comme le « devenir animal » de l’artiste : le territoire, c’est le début de l’art. De ce point de vue, l’art n’est pas le privilège de l’être humain, mais un sous-ensemble de cet immense domaine qui regroupe la couleur, la ligne ou le chant dans l’écosystème global.
Une large partie de votre livre fait la part belle à une philosophie de la « pensée orientée objet » (Graham Harman, Quentin Meillassoux…), qui refonde une nouvelle relation sujet-objet. Comment cette nouvelle objectivité peut- elle impacter les arts visuels ? L’artiste doit-il, comme le dit Hal Foster dans Retour au réel en 2005, « se reconnecter au réel » ?
Je suis assez critique envers le réalisme spéculatif, mais plutôt sur une question de principe : là où il ne voit que des objets, je place des êtres. Considérer le monde comme peuplé de choses, dotées de différents degrés de conscience, n’est qu’une prolongation de la pensée utilitariste, cartésienne, qui nous a amenés à la crise écologique et à l’extractivisme. Si vous voulez, le réalisme spéculatif, c’est la pensée de Descartes, moins l’âme que Dieu aurait octroyé aux humains… Il me semble, à l’inverse, crucial de percevoir le monde comme habité par des sujets : on pourrait résumer mon essai à une tentative d’extension du domaine du sujet, telle qu’elle se donne à voir dans l’art contemporain. Ensuite, le réel n’est pas comparable à la réalité, sociale ou visuelle. Ce dont parle Hal Foster, c’est du réel tel que défini par Lacan : ce contre quoi on bute. Dans Retour au réel, Foster évoque d’ailleurs très souvent la psychanalyse. Le réel est, le plus souvent, invisible. De ce point de vue, le réel de notre temps est le minuscule, le microscopique, l’imperceptible. Ce qui provient de l’anthropocène, dans ce registre du réel, ce serait aussi la prise de conscience que nous sommes immergés. Que le monde est un continuum, et pas une matière première découpable en éléments commercialisables à volonté.
Au-delà du réalisme spéculatif, il existe une « réalité » pour les artistes et les monde de l’art – réalité financière pour les artistes ou réalité politique locale pour les dirigeants d’institutions. Comment envisageriez-vous une politique culturelle qui permette de dépasser le « fétichisme sec » actuel ?
J’ai passé l’essentiel de ma carrière dans des institutions publiques, en France ou à l’étranger. Ce qui est frappant en France, c’est la lente désagrégation de la notion même de politique culturelle : toute volonté d’ensemble semble avoir disparu. Ne reste qu’un réseau à la merci des pouvoirs municipaux ou régionaux. À partir de ce constat, il me semble que la distinction entre secteurs public et privé doit être repensée, et que l’effort collectif devrait consister à défendre les mêmes valeurs dans les institutions républicaines comme dans la société civile. Et la valeur suprême, c’est pour moi l’éducation : la diffusion des savoirs, qui devrait irriguer tous les territoires, toutes les strates sociales. Tout centre d’art est une potentielle université sauvage… Dans cette optique, il faudrait dé-normer, déstandardiser les lieux de culture : pour résumer ma pensée en une formule, je dirais avec Nietzsche qu’« il n’y a pas de faits, seulement des interprétations », et que la culture est la somme d’une pluralité d’interprétations de la culture. Une politique culturelle est une alliance de singularités, une convergence politique vers un horizon commun. Ce que j’appelle le « fétichisme sec », c’est le fétichisme sans contenu qui caractérise les sociétés capitalistes : l’adoration de l’objet, enveloppé dans ce que Marx nommait « l’équivalent général abstrait », l’argent. Disons que je prône une politique des sujets.
- Partage : ,
- Du même auteur : Dialogue sur l’art et la politique, L’impossible impossibilité de l’art ,
articles liés
L’Attitude de la Pictures Generation de François Aubart
par Fiona Vilmer
Erwan Mahéo – la Sirène
par Patrice Joly
Helen Mirra
par Guillaume Lasserre

