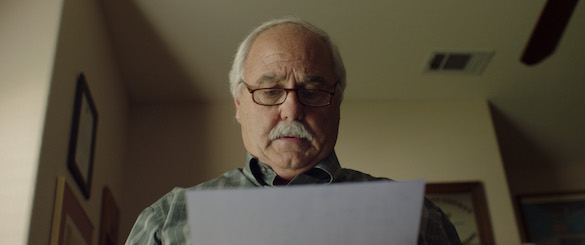Pierre Bismuth, Where is Rocky 2?

2016, 93’*/ Présenté au Festival International du Film de Locarno, du 3 au 13 août
Malgré ce titre aux accents stallonniens, on se rend compte assez vite que le Rocky 2 de Pierre Bismuth n’a pas grand chose à voir avec le célèbre Rocky Balboa, bien que ce dernier s’introduise de manière inopinée à la faveur d’une recherche sur le nom de l’œuvre qui donne son titre au film. Si vous écrivez Rocky 2 dans Google vous aurez plus de chance de voir apparaître des pages dédiées à ce sommet cinéphilique qu’est le deuxième opus de la geste du boxeur résilient que celle d’une œuvre d’un illustre artiste angelino, Ed Ruscha : parmi les nombreuses pistes de lecture enchevêtrées qui composent ce film-valise, la question de la célébrité n’est certainement pas l’une des moindres même si elle se dissimule constamment sous l’apparence d’une quête identitaire plus « classique ». Une des premières séquences du film, celle où le détective missionné par notre réalisateur se met à s’informer sur l’auteur de Rocky 2 est assez édifiante : les personnes que le détective croise en premier sont des représentants éminents de la scène artistique angelinienne qui connaissent parfaitement Ed Ruscha et assurent au détective qu’il s’agit d’un des plus grands artistes américains vivants. Pour l’enquêteur qui, jusqu’au jour où il est investi de cette mission ignorait tout de Ruscha, ce dernier ne commence à exister réellement qu’à partir du moment où il apparaît être l’ami d’autres VIP et notamment de Dennis Hopper, ce qui lui vaut d’emblée une espèce de certificat en célébrité. Est-ce que toute cette entreprise cinémastique n’aurait d’autre but que d’interroger les puissances comparées de la fame en plein pays hollywoodien ? L’incipit du film est une citation d’Ed Ruscha, le personnage autour duquel tourne tout le récit à venir, et elle peut être lue comme le premier indice pour déchiffrer une œuvre à ressorts multiples. Elle nous dit qu’Hollywood n’est pas un lieu mais plutôt un verbe et qu’on peut « Hollywooder » tout le monde et toute chose1. Traduisez : ici, à LA, tout se décline et se conjugue à partir du paradigme hollywoodien, Hollywood est un filtre, une façon de voir le monde en fonction de votre capacité à devenir célèbre ou pas et rien n’existe en dehors de la validation par le circuit des grands studios et de votre habilité à pénétrer ce dernier. Pour autant, Where is Rocky 2 ne porte aucun jugement sur ce système : un peu comme Ed Ruscha, qui en fait un aphorisme, le système hollywoodien devient pour l’auteur le sujet d’expérimentations scénaristiques et le prétexte pour prolonger des questionnements sur le sens et la forme d’une œuvre. Pour un artiste comme Pierre Bismuth, entré un peu par effraction dans ce club très fermé des oscarisés en recevant celui du scénario pour le film de Michel Gondry, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ce rapprochement avec le « système Hollywood » ne pouvait se traduire que par une confrontation avec ce dernier, confrontation non pas frontale mais sous la forme d’une concurrence scénaristique entre une vision classique et romantique (européenne ?), celle d’un détective, qui n’a rien d’un Marlowe, à la recherche d’une œuvre oubliée, réalisée par un célèbre artiste à la fin des années 70 et une forme plus hollywoodienne, presque caricaturale, qui, pour rentrer dans le système doit émarger à la logique du genre, à savoir que la découverte de l’œuvre doit s’accompagner de la révélation tragique d’un secret enfoui et que le désert doit lui-même renvoyer à sa fonction habituelle de cadre aux éternels règlements de comptes entre cow-boys.
Aussi, jusqu’à mi-chemin, le film consiste en l’observation des péripéties investigatrices plus ou moins touchantes et plus ou moins drôles d’un détective ignorant tout ou à peu près des codes et du personnel de l’art contemporain, jusqu’au nom du principal personnage dont il est chargé de retrouver une œuvre — le fameux Rocky 2 — réalisée en 1979 par l’artiste américain et planquée dans un des déserts entourant LA pour on ne sait quelle raison. Ce qui donne lieu à une série de réponses aussi négatives de la part des VIP du monde de l’art s’agissant de savoir s’ils connaissent l’œuvre en question que de réponses positives s’agissant de savoir s’ils en connaissent l’auteur. Le tournant a lieu avec l’entrée en scène d’un duo de scénaristes chargé de rescénariser cette enquête en obéissant cette fois-ci à une logique de dramatisation afin de faire rentrer dans le moule hollywoodien un scénario pour le moins déceptif, intéressant a priori peu de monde à part une petite frange de la population cultivée de LA, celle qui va au musée et qui connaît l’existence du grand artiste. Le film, à partir de ce moment, va suivre ces deux lignes parallèles et incompatibles, respectant leurs rythmes propres et les faisant converger toutes les deux vers leur aboutissement logique, cependant qu’on assiste aux réflexions des scénaristes qui commentent en même temps qu’ils construisent en « temps réel » ce scénario parallèle. Le film devient dès lors un méta récit, une réflexion sur la forme idéale du cinéma.
Alors, que doit-on retenir de ce film aux allures de Nuit américaine 2.0 : l’enchevêtrement des pistes narratives, des déroulés parallèles, l’exercice de virtuosité, ou bien la tentative de portrait de l’artiste ? Ses errances qui le rendent capable de « commettre » une œuvre comme le fait Ruscha, poussant le vice jusqu’à faire un deuxième rocher (d’ou le Rocky 2) parce qu’il s’avère que le premier, fait en pâte de maïs, a les faveurs des animaux du désert qui finissent par le boulotter petit à petit ? Ou la fascination non dite pour le système hollywoodien d’un artiste scénariste qui a la chance de l’avoir côtoyé de près et d’avoir été frôlé par cette addiction qu’on imagine produire les flashes des studios ? Bismuth n’est pas le seul artiste à avoir franchi le pas et à s’être ainsi livré aux sirènes du cinéma : on pense bien sûr à Steve McQueen qui peut apparaître comme un modèle du genre mais qui, du coup, ne conserve que peu de stigmates de son passé de plasticien dans ses récentes productions, ou encore à un Weerasethakul qui, à l’inverse de l’Anglais, impose des rythmes extrêmement longs qui dérogent aux règles du film hollywoodien toujours pressé d’aboutir à son dénouement tragique. À première vue, Bismuth appartient a cette deuxième catégorie, le scénario de Rocky 2 est bien trop complexe pour prétendre à une vie de blockbuster et ses héros sont tous des anti-héros trop « monsieur tout le monde » pour pouvoir postuler à la fame hollyoodienne. Rocky 2 s’inscrit dans une tradition expérimentale du cinéma américain qui va de John Cassavetes à Robert Altman pour incarner une image moins exotique, moins glorieuse et certainement plus vraisemblable de l’Amérique, à l’instar des westerns de Kelly Reichardt (La dernière piste).
Il est tentant d’y voir aussi le portrait de l’artiste célèbre, la relativité de la reconnaissance, la volonté d’invisibilité, l’indifférence par rapport à la transmission, portrait qui se dessine par touches sporadiques plutôt que par longs plans séquences. L’ellipse sied parfaitement à un Ruscha qui pourrait passer pour un modèle de furtivité et son Rocky pour un emblème de la déraison artistique, de sa gratuité, de son inutilité : autant de non qualités qui agacent les profanes (et dont on soupçonne par moment le détective d’en être le représentant poli) mais qui symbolisent la liberté absolue de l’artiste, celle de rajouter des rochers aux rochers, de les perdre volontairement et de s’en ficher un peu même si, du temps de leur création, l’artiste y met une grande énergie en produisant un film qui réapparaît dans celui de Bismuth sous le double statut de document d’archive et de pièce à conviction. Une des scènes les plus touchantes est celle où le détective, accompagné de son comparse improvisé, reprend le chemin qu’avait emprunté quelques 35 années plus tôt Ruscha avec son rocher sur le toit de son pick up, dans un remake tout aussi dérisoire que cette première mouture. Une autre est la scène finale où les mêmes personnages, arrivant au terme de leur épopée, finissent par trouver l’emplacement du rocher, mais se voient privés de son accès — du moins pour le détective — créant pour ce dernier une énorme frustration et provoquant de la part de son compagnon l’énonciation d’une espèce de morale réconfortante. Ce qui dans l’esprit du détective apparaît comme une véritable arnaque devient, dans les paroles de son compère, une leçon de modestie par rapport à l’idée que l’on se fait de la création artistique et de ses énigmes, expliquant, comme si l’on en doutait encore, que ce n’est pas l’instant de la découverte qui compte mais bien tout le chemin parcouru jusqu’à ce moment.
1 : “Hollywood is not just a place, Hollywood is a verb
You can Hollywood something,
You can Hollywood anything”
(Ed Ruscha, 1979)
* France / Allemagne / Belgique / Italie. Hot Docs – Art Basel – Locarno IFF. The Ink Connection / Vandertastic / Frakas Productions / In Between Art Film & Vivo Film / ZDF.
- Partage : ,
- Du même auteur : Capucine Vever, Post-Capital : Art et économie à l'ère du digital, Chaumont-Photo-sur-Loire 2021 / 2022, Paris Gallery Weekend 2021, Un nouveau centre d'art dans le Marais. (Un tour de galeries, Paris),
articles liés
L’Attitude de la Pictures Generation de François Aubart
par Fiona Vilmer
Erwan Mahéo – la Sirène
par Patrice Joly
Helen Mirra
par Guillaume Lasserre